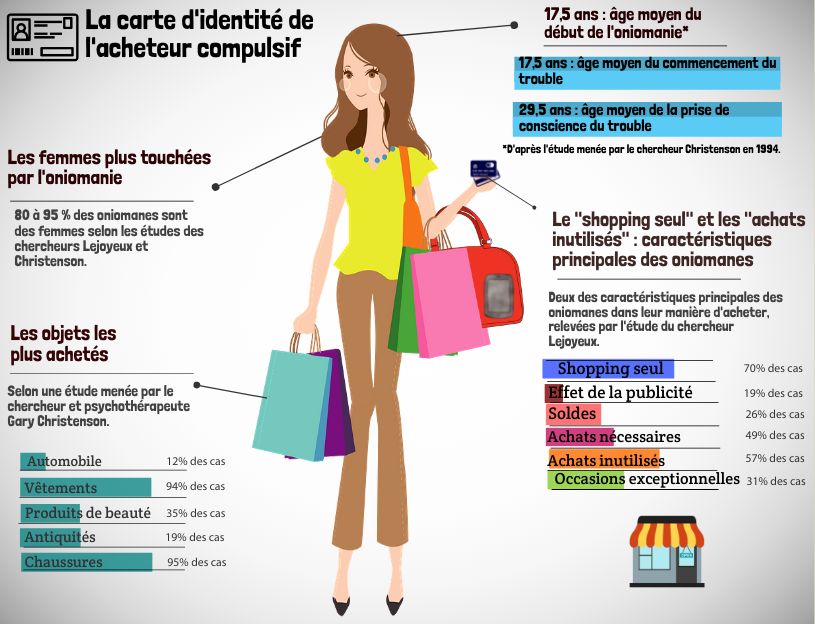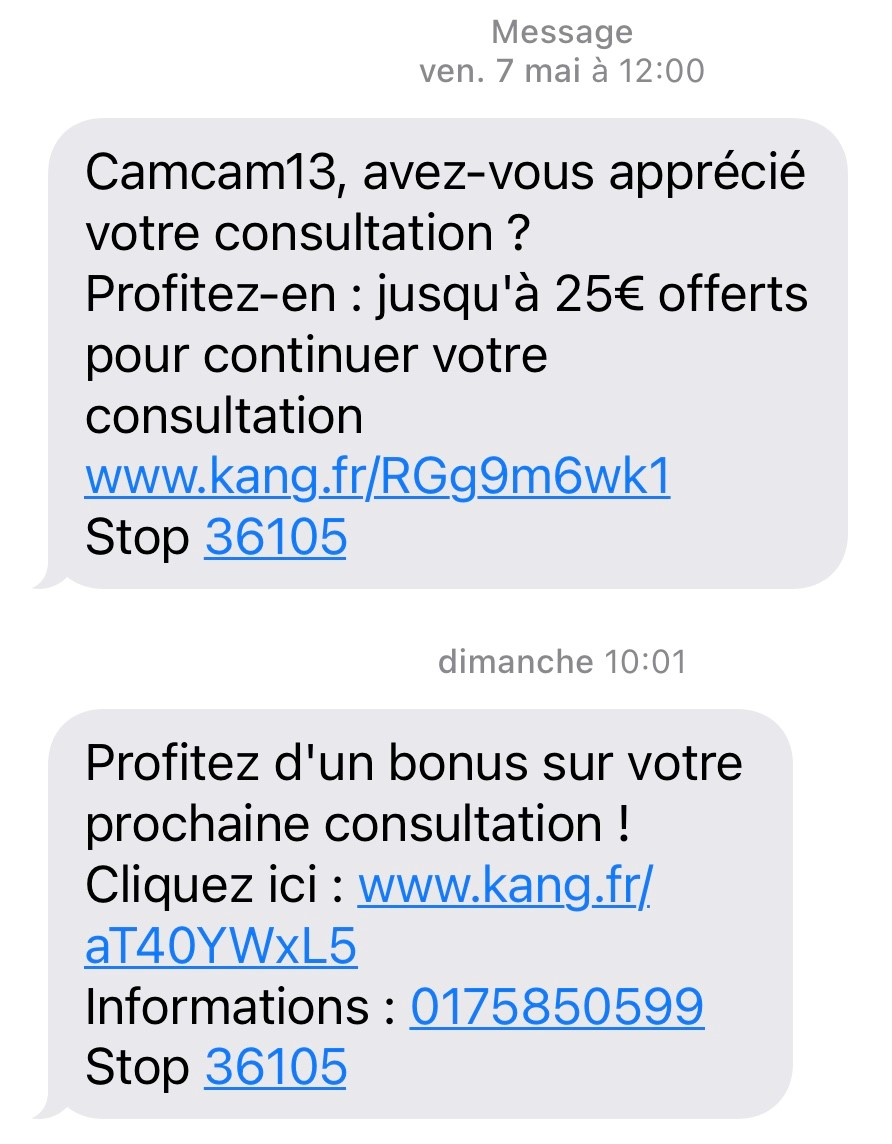Tabac, sucre, cocaïne, alcool, jeux, sexe … L’hypnose est supposée pouvoir soigner tout type d’addiction. De plus en plus populaire dans le milieu médical, cette pratique suscite pourtant toujours des débats. Enquête.
Assis sur une chaise à roulette, Benjamin* regarde fixement une figurine de singe en plastique. Ses mains sont posées sur ses genoux. Sa casquette plate est vissée sur sa tête. Et ses paupières se ferment sous ses lunettes. L’homme de 63 ans est concentré. Il se fait hypnotiser.
En ce début d’après-midi du vendredi 7 mai, le temps semble s’être arrêté dans les locaux de l’association Charonne Oppélia, un centre de soin dans le 13e arrondissement de Paris. « Je vous invite à prendre quelques bonnes respirations et à fixer votre regard sur cette petite figure qui est en face de vous. Vous focalisez votre regard de façon tellement intense que tout votre champ se réduit à cette figure », indique la voix calme du docteur Jean-Marc Geidel.
« Je me sens plus léger »
Depuis près de quatre ans, Benjamin se rend ici une fois par mois pour une session d’hypnose. Pendant de longues années, ce jeune retraité a vécu une dépression qui l’a fait tomber dans l’alcoolisme. Benjamin a été suivi par une psychiatre pratiquant l’hypnose conversationnelle, une technique de suggestion où le patient et l’hypnothérapeute échangent en utilisant des métaphores. Grâce à ces images, le professionnel s’adapte au monde de la personne à soigner.
Aujourd’hui, délivré de son addiction à la boisson, Benjamin a recours à l’hypnose pour se retrouver lui-même. « Les addictions, ça détruit sur le moment où vous êtes dépendant mais ça détruit aussi après », explique le docteur Jean-Marc Geidel. « Et donc l’hypnose peut aussi être très intéressante dans la phase de reconstruction. Comment se retrouver alors que pendant tellement d’années, toute la vie était rythmée par l’alcool ? »
Cet après-midi, Benjamin travaille sur ses émotions. Depuis ce matin, il se sent triste. Dans le petit bureau, la voix du docteur Geidel le guide dans sa transe hypnotique. « Votre esprit est tellement léger, tellement léger qu’il va prendre de la hauteur et déjà votre esprit monte au-dessus de ce bâtiment. Tandis que votre corps reste assis à se reposer sur cette chaise », énonce le médecin.
À lire aussi: Soigner soi-même ses addictions grâce à l’autohypnose
Pendant une vingtaine de minutes, Jean-Marc Geidel aide Benjamin à se construire d’images mentales. Puis, le docteur l’invite à ce que son esprit se reloge dans son corps resté sur Terre. « Et tout doucement, vous descendez, vous descendez, vous approchez de la ville », indique le médecin hypnothérapeute. « L’ensemble, corps plus esprit, va maintenant s’éveiller tranquillement de cette séance d’hypnose », poursuit-il. Alors Benjamin émerge. Sous son masque blanc, il baille. Ses mains passent ensuite sous ses lunettes. Il se frotte les yeux avant de s’étirer. L’ambiance dans la pièce est douce. Sur les murs blancs, le soleil manifeste sa présence au travers des stores vénitiens. « J’étais lourd. Et là, je me sens plus léger », remarque spontanément Benjamin. La séance est terminée.
Des séances « sur-mesure »
L’hypnose peut donc permettre la reconstruction post-addiction. Elle peut aussi aider à se délivrer d’une addiction. Les techniques diffèrent selon les professionnels et les patients. C’est du sur-mesure. Parmi elles, l’hypnose classique, l’hypnose conversationnelle ou encore les thérapies d’activation de conscience. Jean-Marc Geidel soutient que tout le monde serait réceptif à l’hypnose, mais pas de la même manière. Chaque hypnothérapeute ne pourrait donc pas réussir à hypnotiser chaque individu.
Pour un résultat satisfaisant, l’entretien préalable à une session d’hypnose est important. Il permet d’établir un premier lien entre le patient et le professionnel. « Le levier principal, c’est une communication. Si la relation est là, la confiance est là, on a fait au moins la moitié du chemin voire les trois quarts », explique Isabelle Bechu, psychologue et hypnothérapeute. En plus de créer un climat de confiance avec le patient, cet entretien est fondamental pour « chercher le point d’appui », indique Jean-Marc Benhaiem, docteur et hypnothérapeute en région parisienne. C’est-à-dire connaître les croyances, les visions et les désirs du patient. « Une fois le point d’appui trouvé, la séance commence et on peut modifier la vision, la perception de la chose pour qu’il puisse s’en détacher », poursuit le professionnel de la santé. La substance consommée par les patients peut être la même, mais ces derniers peuvent la prendre pour des raisons différentes. « Ce n’est pas tellement liée au produit que les patients utilisent mais à ce qu’ils attendent de ce produit. Par exemple, quelqu’un qui combat son anxiété par de l’alcool ou de l’héroïne, on va l’aider, par l’hypnose, à trouver une autre manière de lutter contre son anxiété », souligne Dina Roberts, psychiatre et hypnothérapeute à l’hôpital Marmottan, un centre d’addictologie, dans le 17e arrondissement de Paris.

Un rythme des consultations variable
Chaque médecin a un avis personnel sur le rythme des séances. Pour Dina Roberts, il n’y a pas de règle. Parfois ses patients viennent une fois. Parfois ils viennent la voir chaque semaine. Pour un sevrage tabagique, la professionnelle observe qu’il suffit en général d’une consultation. « Quand on dit que c’est court, ça ne veut pas forcément dire que c’est miraculeux », nuance-t-elle. « Souvent les gens disent après une séance, qu’ils ont la sensation de retrouver un équilibre. Par exemple : arrêter de consommer le produit quand on est angoissé mais juste le consommer quand il y a du plaisir », poursuit-elle.
« On ne va pas mettre le patient dans la dépendance du thérapeute, car l’idée est qu’il en sorte »
Jean-Marc Benhaiem propose des séances d’hypnose qui durent entre 45 minutes et une heure. Il n’est pas forcément favorable à ce qu’un patient revienne trop régulièrement. « On ne va pas mettre le patient dans la dépendance du thérapeute, car l’idée est qu’il en sorte ». Pour Nathalie Legard, 46 ans, deux séances étaient prévues pour qu’elle arrête le tabac. Finalement, une session en novembre 2020 suffira. Après 35 ans de tabagisme, à raison d’un paquet quotidien, elle n’a plus retouché à une cigarette. « J’ai l’impression que l’hypnothiseuse a appuyé sur un interrupteur », témoigne cette femme, agent d’accueil dans un lycée de Mayenne.
Jean Becchio, médecin généraliste et hypnothérapeute dans le Val-de-Marne, est un défenseur du traitement sur le long cours, pouvant aller de quatre à six mois. Pendant trente ans, il a utilisé l’hypnose pour aider ses patients à se libérer de leurs addictions. « L’addiction, c’est quand on a pris une drogue pendant des années, ou des mois. Cela crée des réseaux très particuliers dans des régions du cerveau. Il faut réussir à en provoquer de nouveaux », explique-t-il.
Bien que les spécialistes utilisent différentes méthodes, ils se rejoignent sur le fait que la motivation personnelle des patients est essentielle. « L’hypnose peut aider une guérison. Elle peut aider à se libérer d’une addiction pour quelqu’un qui est déjà dans ce chemin-là », explique Dina Roberts.
L’hypnose a-t-elle vraiment des effets thérapeutiques ou repose-t-elle sur la croyance et la volonté du patient ? Quelle place pour l’effet placebo ? Pour Jean-Marc Geidel, « l’hypnose n’est rien d’autre que l’effet placebo. C’est l’imaginaire qui crée du réel ». L’hypnose fonctionne donc si la personne hypnotisée est persuadée des effets positifs. « Quand un patient vient me voir, je lui dis que l’effet placebo participe sûrement. Et alors ? Vous préférez être guéri par l’effet placebo ou ne pas être guéri du tout ? », ajoute Isabelle Bechu.
Des résultats mitigés
Si la discipline a trouvé des adeptes, elle ne fait pas pour autant l’unanimité. Dominique Barrucand a 88 ans. Ce médecin psychiatre a écrit Histoire de l’hypnose, un ouvrage consacré à l’étude de cette discipline depuis ses origines. Il a beaucoup pratiqué l’hypnose au début de sa carrière. Aujourd’hui, il doute de l’efficacité de cette technique pour soigner les addictions : « Je ne serais pas favorable à traiter une addiction par l’hypnose parce que si l’on veut avoir des bonnes chances de succès, il faut non seulement que le sujet soit d’accord. Mais aussi qu’il soit tout à fait conscient de ce qu’il fait et des efforts qu’il fait. » Selon lui, les addictions nécessitent un traitement adapté, une psychothérapie personnalisée, car l’arrêt de tabac ou d’une autre drogue nécessite un effort colossal. Chef d’un service de traitement des addictions, il n’a jamais utilisé cette technique dans un but de sevrage.
De même, un médecin psychiatre parisien souhaitant rester anonyme, explique pratiquer de moins en moins l’hypnose pour le traitement des addictions. Sur 1000 consultations dans l’année, il affirme ne pouvoir aider que trois à quatre patients, « un taux de réussite très faible » selon lui. « J’arrive beaucoup mieux à utiliser l’hypnose pour des problèmes d’anxiété et de sommeil, indique-t-il. Pour les addictions, cela dépend de beaucoup d’autres facteurs ». En effet, selon le psychiatre, le traitement des addictions ne peut pas entièrement être assuré par l’hypnose. Elles sont souvent associées à des facteurs qui ne peuvent pas être pris en charge, notamment l’ambiance familiale dans laquelle vit le patient.

À lire aussi: De Mesmer à Milton Erickson : retour sur l’histoire de l’hypnose
Un statut ambigu
Les formations universitaires d’hypnose ne sont pas reconnues par l’Ordre des médecins, malgré les demandes du SNH (Syndicat national des hypnothérapeutes). Enseignée mais non reconnue, l’hypnose a donc un statut à part. « Hypnothérapeute, ce n’est pas une profession, c’est une spécialité qui peut s’ajouter à la formation des professionnels de santé », précise Jean-Marc Benhaiem. Ce docteur a créé le premier diplôme universitaire d’hypnose médicale à la Pitié Salpêtrière. Au départ, il y avait peu d’inscriptions. Désormais, les candidatures explosent : « On a entre 200 et 300 demandes chaque année pour environ 80-90 places. » De même, l’hypnose est désormais utilisée dans de nouveaux secteurs, notamment dans le cadre d’interventions chirurgicales. Proposée comme une alternative à l’anesthésie classique, elle permettrait de diminuer l’anxiété du patient et les effets post-opératoires.
L’hypnose reste une pratique médicale coûteuse. Son remboursement dépend des praticiens et des mutuelles. Manon Rousseau, mère au foyer, n’a pas pensé à se rapprocher de son assurance santé. En 2019, elle se lance, avec son mari, dans une PMA (Procréation médicalement assistée) et décide alors d’arrêter de fumer. Lassée des patches, à ses yeux inefficaces, elle prend rendez-vous avec un hypnothérapeute en octobre 2019. Après une séance d’une heure, elle ne retouche plus à la cigarette. Et pourtant, ce n’est pas la solution miracle selon elle. Avec près de 250 euros déboursés dans l’hypnose, « j’ai la conviction que c’est le fait que ça m’ait coûté cher qui m’a motivé », confie la jeune femme de 28 ans.
Nolwenn Autret et Aglaé Gautreau
*Le prénom a été modifié.