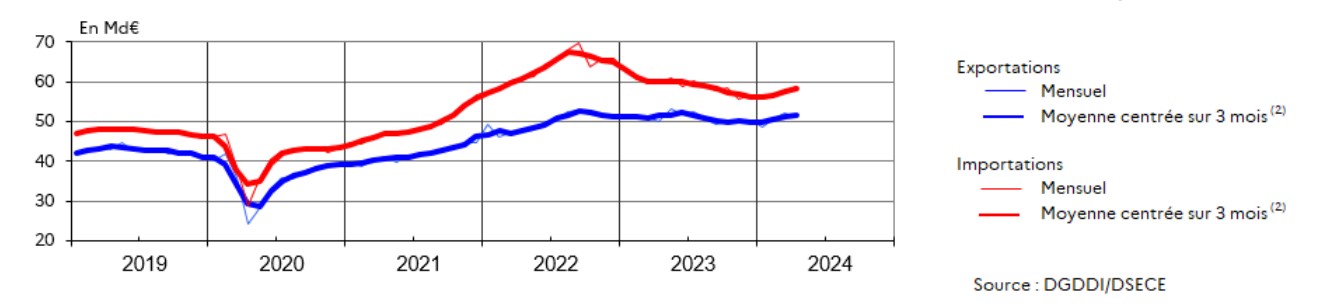À la veille de la sortie de son nouvel album, le groupe américain Twenty One Pilots porte plainte contre Temu, l’accusant de vendre « des myriades d’articles qui ne sont que contrefaçons et copies flagrantes » de leur merchandising. Une problématique connue sur les plateformes de e-commerce, malgré les réglementations mises en place.
C’est un évènement commercial majeur pour un groupe : l’album du duo états-unien Twenty One pilots sort ce jeudi 12 septembre, une occasion de vendre les multiples produits à son effigie disponible sur le site officiel.
Le merchandising musical étant onéreux, il faut débourser aux alentours des 40€ pour obtenir un T-shirt. Or, des articles similaires bien moins coûteux sont disponibles par centaines sur le site de e-commerce chinois Temu — un problème pour le groupe, qui perd ainsi de potentiels clients — sans accord préalable de la part du duo. La plateforme peut utiliser son statut d’hébergeur afin de minimiser ses obligations.
« Twenty three Pilots »
Face à cette infraction, le géant de l’industrie musicale —plus de 10 millions de disques vendus et 12,3 milliards de streams sur Spotify en 2022— se trouve démuni. Les représentants du groupe, Josh Dun et Tyler Joseph, ont ainsi porté plainte contre le site pour contrefaçon de marque, concurrence déloyale et fraude par ressemblance, soulignant que « des myriades d’articles qui ne sont que contrefaçons et copies flagrantes » sont en vente. Plus de 12 pages de photos d’articles contrefaits du groupe ont été relevées.
Pour sa part, la plateforme déclare au CelsaLab » respecte[r] les droits de propriété intellectuelle des tiers et traite[r] avec le plus grand sérieux toute réclamation relative à la contrefaçon », mais aussi défendre « fermement » ses intérêts « face à toute allégation infondée ».
En naviguant sur Temu, la recherche « Twenty One Pilots » ne présente plus aucun résultats. En revanche, en tapant « Twenty three Pilots », l’utilisateur voit s’afficher des centaines de produits reprenant le logo du groupe et les visuels de ses albums, dont « Breach », à paraître le 12 septembre : les T-shirts présentés coûtent aux alentours de 15€, contre environ 40€ sur le site officiel. Ce changement de mots clés semble être voué à camoufler ces produits.
De plus, en consultant les différentes annonces, on constate que les comptes les hébergeant vendent également de nombreux produits à l’effigie d’autres groupes de musique (a-ha, System of a Down, The Cure…), cette pratique s’avérant faire système.
Les plateformes de e-commerce face à la justice
« L’atteinte aux droits de propriétés intellectuelle sur les plateformes de e-commerce est récurrent », confirme Vincent Rodriguez, avocat en droit de la propriété intellectuelle. « Cette catégorie regroupe plusieurs types de contrefaçons : dans le cas de Twenty One Pilots, il s’agit de contrefaçon de marque, le nom du groupe en étant une déposée aux Etats-Unis. L’atteinte globale aux droits de marque peut concerner ses propriétés, brevets, dessins et modèles ».
Quant aux obligations des plateformes sur ces risques de fraude, elles ont « évolué depuis le DSA (Digital Service Act) », entré en vigueur en 2022.
Leur nature dépend essentiellement de la qualification de la plateforme, pouvant être « hébergeur » et donc « mettre à disposition une plateforme aux internautes sans rien publier », ou « éditeur », « qui participe de manière active à ce qui est publié ». Dans ce dernier cas, elle a davantage de responsabilité et doit s’assurer de l’absence de contrefaçon avant même que l’annonce soit mise en ligne.
« Avant le DSA, Temu était considéré comme hébergeur », affirme Vincent Rodriguez, déclarant néanmoins que ce statut « peut changer selon les décisions juridiques », telle que celle qui pourrait être rendue à l’issue de cette plainte. Les hébergeurs doivent « afficher le nom des vendeurs professionnels, et mettre à la disposition des internautes un moyen de signaler les produits contrefaisants ».
Des artistes au cœur de batailles juridiques
Une contrainte s’avérant peu respectée, les titulaires de droits devant bien souvent mettre en place leurs propres mesures ou naviguer par eux-même sur ces plateformes pour constater les fraudes. Le 4 août dernier, l’illustratrice britannique Micaela Alcaino découvrait ainsi que ses images avaient été imprimées sur « des couvertures, des serviettes, des tapis, et même des rideaux de douche » et « exhort[ais] » ses collègues designers, illustrateurs et éditeurs à « regarder si Temu vend [leurs] œuvre sans [leur] consentement ».
En effet, les titulaires de droits peuvent « rencontrer de nombreuses difficultés » pour prendre connaissance de contrefaçons ayant été créées sur la base de leur travail, ajoute Vincent Rodriguez. En cause, le « flux continu d’annonces » et de leur « mise en place automatisée ». Pour contrer ce problème, ils peuvent « mettre en place des surveillances à partir d’une banque d’image, qui détecte les annonces contenant des visuels identiques ou proches grâce à l’intelligence artificielle ».
Margot Mac Elhone