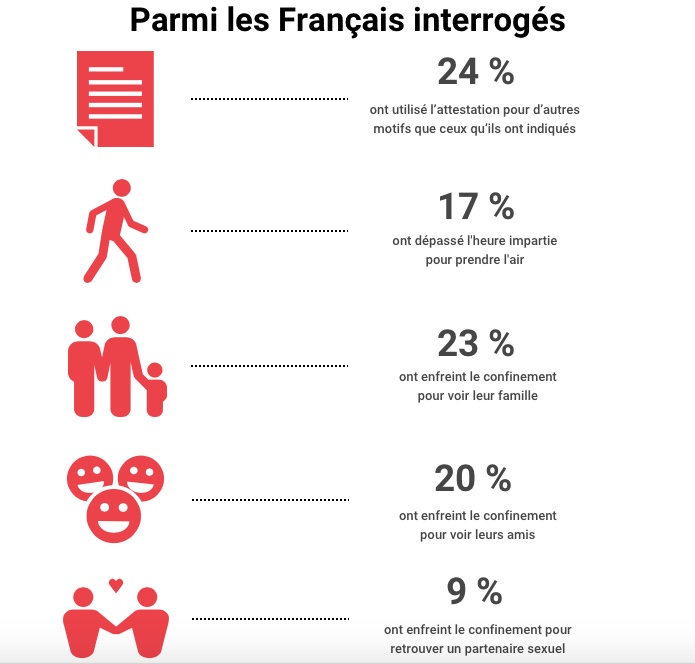Le smartphone prend de plus en plus de place dans nos quotidiens. Il se rend indispensable, tout en se présentant comme un remède facile à nos angoisses. Certains en viennent à se considérer dépendants, voire addicts, à leur téléphone portable.

Il est 17 h 30, l’heure de pointe dans le métro parisien. Les travailleurs et les étudiants s’agglutinent les uns à côté des autres. Regards vides, bouches et nez masqués, ils scrutent leurs mains. Ou plutôt, leur téléphone portable. D’après le Conseil supérieur de l’audiovisuel, les Français passent en moyenne 1 h 51 par jour sur leur portable. Un chiffre en constante augmentation depuis la création du smartphone par Apple, en 2007. Et renforcé par la pandémie de Covid-19.
« Plutôt que de ne rien faire, tu ne fais rien, mais sur ton téléphone. » Florian P., jeune Rennais diplômé en robotique, se considère dépendant à son téléphone. Il y passe deux à trois heures par jour, entre réseaux sociaux, messages, appels téléphoniques et recherches Internet. Pour autant, peut-on réellement parler d’addiction ?
L’addiction au smartphone n’est pas reconnue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Pour être qualifiée d’addiction comportementale (car aucune substance n’est consommée ici), elle doit cocher plusieurs cases : difficulté au sevrage, éloignement de la famille ou encore augmentation des “doses” pour obtenir la même satisfaction. “C’est encore dans le champ de la recherche, explique Baptiste Morize, interne en psychiatrie à l’hôpital Sainte-Anne, mais je pense qu’on va arriver à le considérer comme une addiction.” Le débat porte par exemple sur un temps quotidien d’exposition aux écrans, à partir duquel l’usage du smartphone deviendrait nocif. “Cela devient un trouble en santé mentale le jour où tu n’es plus capable de répondre à tes activités de base, professionnelles, sociales ou affectives,” ajoute-t-il.
Le smartphone est à la fois une montre, une carte routière, un livre de cuisine, une télévision, et bien sûr un accès direct aux réseaux sociaux. « Le smartphone, c’est pratique, facile, immédiat”, analyse Francis Brochet, journaliste et auteur de plusieurs ouvrages sur les usages du smartphone. Le téléphone portable est, littéralement, sans cesse à portée de main. « J’utilise mon smartphone pour aller sur YouTube, sur les réseaux sociaux, pour trouver une recette, pour lancer un minuteur, pour me réveiller, pour mon trajet, même si je connais le chemin. Et puis pour contacter mes proches. » développe Helena R., 23 ans, qui considère son téléphone “comme l’extension de [sa] main.” Le smartphone est devenu un outil indispensable. On peut facilement y passer des heures, sans même s’en rendre compte. C’est le cas de Florence T., 49 ans, mère au foyer. Gérant les activités de ses cinq enfants, organisant sa vie associative, échangeant avec ses amies, elle peut parfois passer deux heures rien que sur WhatsApp, même en marchant.
Zoom sur ces villes qui s’adaptent au smartphone.
« Quand on le voit, on a envie de l’allumer »
On pourrait se dire que l’on est dépendant dès lors que l’on est, des heures durant, scotché à son smartphone. Florian P. y passe deux heures dans la journée alors que Helena R. peut parfois y rester dix heures. Selon Michael Stora, psychologue et psychanalyste spécialisé dans le numérique, l’addiction au smartphone se manifeste surtout dans la gestuelle. Un consommateur de tabac ne peut s’empêcher de porter quelque chose à sa bouche. De la même manière, les personnes accros à leur smartphone déverrouillent inlassablement leur écran. Bénédicte Pierron, doctorante en sémiotique, l’analyse d’ailleurs comme intrinsèque au smartphone. “Quand vous voyez une chaise, vous voulez vous asseoir. Avec un smartphone c’est pareil : quand on le voit, on a envie de l’allumer”, explique-t-elle. Selon le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC), les Français consultent leur téléphone toutes les dix minutes, pour une durée de trente secondes. “Le seul moyen pour moi d’être concentrée sur mes révisions, c’est de mettre mon portable en mode avion et de l’enfermer dans mon sac” constate Caroline P., étudiante en droit de 20 ans.

Bien que beaucoup de jeunes témoignent facilement de leur dépendance à leur smartphone, les études montrent qu’ils ne sont pas forcément les plus touchés. “Ce n’est pas une question d’âge ! Il y a un discours rebattu des adultes qui prétendent que les jeunes sont dépendants. J’estime que c’est un discours moral. Des tas de personnes de 50 ans abusent du smartphone” s’exclame Francis Brochet. Il est néanmoins clair que les pratiques divergent d’une génération à l’autre. Chez les personnes travaillant avec l’outil numérique, la frontière entre le temps de travail et le temps personnel s’atténue, c’est ce que l’on appelle le blurring. Pierre P., cadre dans la fonction publique de 53 ans, en fait les frais. “Mon téléphone participe de la confusion totale entre les deux mondes, ma vie familiale ou mes relations peuvent-être interrompues par des temps de téléphone, sans que je puisse m’y soustraire.”
Nous saisissons notre téléphone juste le temps de regarder l’heure, vérifier que nous n’avons pas rater un appel ou un message important. Cette peur est commune et de plus en plus étudiée, elle est surnommée FOMO, pour Fear of Missing Out, autrement dit la peur de rater quelque chose, qu’un événement se passe sans que nous soyons au courant. Les réseaux sociaux en sont un amplificateur : on peut tout savoir, tout le temps et donc on y retourne. “Je me rends compte que je tourne en rond sur mon téléphone : je ferme Instagram, je vais sur Twitter, je ferme Twitter, je retourne sur Instagram… Il n’y a pas grand-chose qui a changé depuis que j’ai quitté l’application trente secondes plus tôt”, raconte Florestan V., étudiant de 18 ans.
Zoom sur l’économie de l’attention.
Pour qualifier la relation entre l’utilisateur et son smartphone, Michael Stora parle de “doudou sans fil”. « Quand on est confronté à des moments d’incertitude, d’angoisse, on va dégainer. On ne s’en rend pas toujours compte : cet objet-là nous empêche de penser à nous, de nous confronter à nous-même ». Par exemple, lorsque l’on attend dans une file ou que l’on est dans le métro. Lou B., 23 ans, étudiante en cinéma, ne décroche pas de son téléphone dès qu’elle est dans les transports en commun : « J’ai l’impression de faire semblant de regarder mon portable, alors même qu’il n’y a rien, et c’est surtout pour éviter le regard des gens« . Cette conscientisation de l’objet en tant que doudou peut passer par une remarque d’autrui, ou par son rapport personnel à l’objet. Selon Michael Stora, « c’est quand on est confronté à un accident : plus de batterie ou un vol, qu’on prend conscience » de cette dépendance. Difficile donc de réaliser que l’on est accro si l’on n’essaie pas de se passer de son smartphone.
« Le numérique est un révélateur, un facilitateur, un amplificateur de problématiques déjà présentes. » Michael Stora
C’est aussi pour calmer l’anxiété que les personnes dépendantes consultent leurs réseaux sociaux très régulièrement. Elles sont poussées en permanence à vérifier qu’elles n’ont pas de notifications. Dans le cerveau, le système de récompense procure un plaisir immédiat lorsque l’on reçoit un “like” sur les réseaux sociaux, un commentaire positif ou un message privé. Ce processus libère instantanément de la dopamine et de l’endorphine, les hormones du plaisir et du bien-être. Le neurobiologiste Jean-Pol Tassin sur France Culture, explique que c’est la répétition de libération de ces hormones qui participent grandement à la volonté de retourner régulièrement sur ces réseaux sociaux, à l’instar d’autres addictions. Si le parallèle peut être fait, il insiste sur l’impossibilité à l’heure actuelle de parler d’addiction au smartphone.

« Le numérique est un révélateur, un facilitateur, un amplificateur de problématiques déjà présentes », selon Michael Stora. La recherche de l’immédiateté n’a pas commencé avec l’avènement du smartphone. “L’individu souhaite être au fait des dernières informations, il trouve dans le smartphone un partenaire efficace”, affirme Bénédicte Pierron avant de déclarer que “le smartphone est un instrument d’ubiquité”. Cela expliquerait la nomophobie, la peur de ne pas avoir son téléphone sur soi et donc de rater quelque chose. Quelque part, le smartphone permet de pallier la crainte d’être seul avec soi-même sans prendre part à la marche du monde.
« J’ai eu l’impression de me détacher d’un poids »
Le risque de la dépendance au smartphone est, justement, de perdre sa relation à soi. Morgane P., 31 ans, raconte avoir ressenti le besoin de laisser son téléphone dans un tiroir pendant deux semaines. “C’était une période difficile, où j’étais un peu triste et où j’avais besoin de m’éloigner. Et ça m’a fait du bien, j’ai eu l’impression de me détacher d’un poids”, raconte cette infirmière habitant près de Nancy. Bien qu’elle se considère toujours dépendante de son smartphone, Morgane P. a réussi à prendre un peu plus de distance avec lui après ces deux semaines. Et c’est une expérience qu’elle compte renouveler prochainement.
Le fait de se passer complètement de smartphone pendant une durée déterminée s’apparente à une détox digitale. Nombreux sont ceux qui ressentent le besoin de prendre un temps loin des notifications. Sur YouTube, par exemple, on ne compte plus les vidéos dans lesquelles des personnes racontent leur expérience ou donnent des conseils. Des agences de voyages se sont même spécialisées dans l’organisation de séjours de ce type. Au programme : yoga, méditation ou randonnées dans un cadre calme et bucolique, loin de l’agitation des villes. Des séjours chers, que tout le monde ne peut pas s’offrir. Mais aussi une solution plutôt discutable, qui n’aboutit pas à une meilleure maîtrise de l’usage de son smartphone après coup.
Selon Francis Brochet, il faut d’abord “comprendre que le numérique et le smartphone sont des moyens et pas des fins.” Il n’y a pas de solutions universelles pour réussir à se détacher de cet outil. Florence T., par exemple, refuse d’ utiliser son smartphone comme un réveil et Pierre P. a désactivé la totalité de ses notifications. Tous les spécialistes s’accordent sur la nécessité de ces mises en place, y compris pour eux-même. “Il ne s’agit pas de rejeter mais de trouver la raison de ce qui ne va pas dans l’utilisation du smartphone, selon le psychologue Michael Stora, l’idéal est de partager”. Lui-même préfère mettre en place des temps lors desquels, ses enfants et lui, se partagent leurs découvertes en ligne. Le journaliste Francis Brochet, quant à lui, s’interdit d’emporter son téléphone à table et dans sa chambre, tandis que Bénédicte Pierron, doctorante en sémiotique, se contraint à faire des trajets sans utiliser d’application de géolocalisation. Plus radical, Baptiste Morize, interne en psychiatrie, a désinstallé toutes les applications de réseaux sociaux de son téléphone, afin de se “dégager du temps de cerveau”.
Bénédicte Gilles et Clemence Diligent