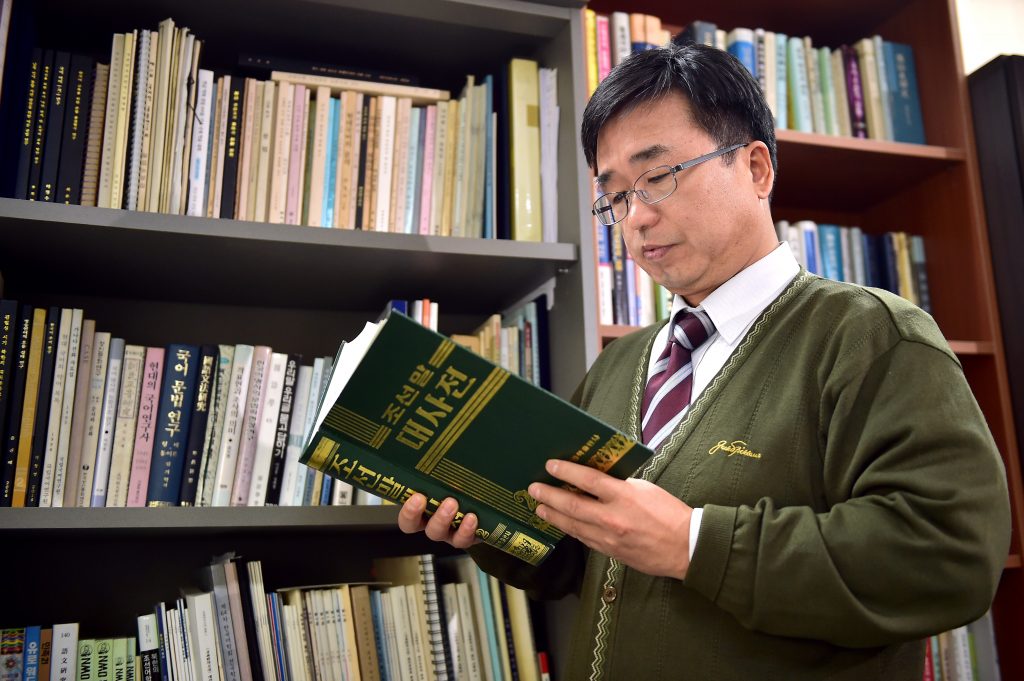La loi « fake news » a été adoptée en seconde lecture par les députés de l’Assemblée nationale, dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 octobre. La création d’un conseil de presse est prévue dans le texte législatif, emboitant le pas à d’autres pays européens.

Si la loi fake news ne fait pas consensus parmi la classe politique -certains la jugent inutile, voire liberticide- le projet de création d’un conseil de presse, mis en avant par la ministre de la Culture Françoise Nyssen, met quasiment tout le monde d’accord. Jean-Luc Mélenchon, député La France Insoumise, s’est d’ailleurs félicité mardi 9 octobre que le gouvernement reprenne sa proposition de mise en place d’un organe qui veillerait sur le bon fonctionnement des médias français.
Nous avons proposé la création d’un conseil de déontologie des médias. Une organisation de ce genre existe dans une quarantaine de pays. #FakeNews#DirectANhttps://t.co/qlXwRvtUJR
— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 7, 2018
Un organe d’autorégulation
Un tel projet est également vu d’un bon œil par le Syndicat National des Journalistes (SNJ). La secrétaire générale Dominique Pradalié plaide depuis longtemps pour qu’un conseil de presse voit le jour et qu’il ait pour « mission de se saisir ou d’être saisi d’un dysfonctionnement dans un média, d’effectuer une enquête complète et d’émettre un avis ».
Pour Florent Desarnauts, avocat spécialiste du droit des médias, « si le projet français ne prévoit pas que le conseil puisse demander au média visé de diffuser un rectificatif, l’utilité d’un tel organisme est limitée. » Ce type d’instance existe déjà en Belgique, où le Conseil de Déontologie Journalistique (CDJ), créé en 2009, « peut être saisi par les citoyens, rend des avis et a le pouvoir de demander au média concerné de diffuser un rectificatif, que l’organisme a lui-même rédigé », explique maître Desarnauts.
Un conseil alliant journalistes, éditeurs et société civile
D’un point de vue légal, le statut conféré à un tel organisme pourrait s’apparenter à celui de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, soit celui d’une association de la loi de 1901, éclaire Florent Desarnauts. Pour le moment, le statut juridique d’un tel conseil de presse n’a pas été précisé, pas plus que sa composition. Françoise Nyssen a simplement évoqué une instance associant journalistes, éditeurs et société civile. Pour Dominique Pradalié, qui juge par ailleurs liberticide l’ensemble de la loi « fake news », une composition paritaire est indispensable pour un gage d’indépendance et de transparence.
Pour autant, il faudrait, selon la secrétaire générale du SNJ, que les employeurs de presse soient intégrés au sein du conseil. Car ces derniers ont déjà manifesté leur désaccord face à un tel projet. En 2014, une première consultation organisée par le ministère de la Culture avait recueilli les ressentis de la profession et s’était heurté à la frilosité des patrons de presse. « Les employeurs qui bloquent, c’est exactement le point nodal de difficulté, parce qu’un conseil de presse démontrerait les manipulations, estime Dominique Pradalié. Ce sont les mêmes qui bloquaient en Belgique l’établissement d’un conseil de presse, sauf que les autorités gouvernementales ont pris leur responsabilité et leur ont dit « les aides à la presse iront à tous ceux qui entreront dans le conseil ». Résultat, les employeurs ont trouvé ce conseil génial et y sont tous rentrés. »
Le @SNJ_national réclame une instance nationale de déontologie depuis des années mais quel est le «mandat» de @emmanuelhoog ? Le journaliste ne peut être « jugé » que par ses pairs #charte1918. @vinclanier@dpradalie#Nice#Nice06pic.twitter.com/xPT4fzFrh9
— NiceRendezVous (@actualites_nrv) 9 octobre 2018
Le dossier a été confié à l’ancien PDG de l’AFP, Emmanuel Hoog. Pour le SNJ, le problème n’est pas tant l’homme que le manque de transparence autour de ses attributions. C’est ce qu’explique Dominique Pradalié : « Nous nous posons des questions sur le cadrage de la mission qui lui est confiée. Nous n’avons pas d’informations à ce sujet et c’est quand même important. »
Conformément à la navette parlementaire, le texte doit repasser une nouvelle fois devant les sénateurs, avant d’être soumis à un vote final.
Caroline Quevrain