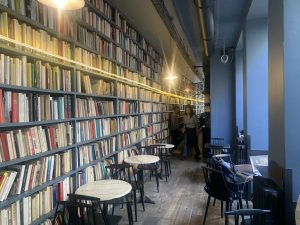Depuis des mois, plusieurs données mettent en évidence une diminution inquiétante des espèces d’oiseaux en Guadeloupe, qu’elles soient menacées ou non. Parmi les plus concernés : le pélican brun, chassé par les habitants.
De l’imposant pélican brun au discret colibri, la Guadeloupe dispose d’une grande variété d’oiseaux sur son territoire. 295 espèces y sont recensées. Pourtant, leur nombre pourrait diminuer ces prochaines années, conséquence de la nette réduction des populations ces dernières décennies.
Parmi les plus espèces les plus concernées : le pélican brun, emblématique oiseau de l’île, qui a même donné son nom à la commune littorale du Gosier (l’oiseau s’appelle « Gwan Gosyé » en créole). Si jusqu’en 2020 les individus peuplaient encore la Guadeloupe, ils n’y nichent désormais plus, à l’exception d’une petite colonie qui s’est installée dans l’archipel des Saintes.
Victimes de la chasse
La population de pélicans bruns au Gosier a atteint son apogée dans les années 2010 mais, très vite, les habitants se sont permis de les chasser, gênés par leur nombre et leurs déjections. « Ils ont coupé les arbres où nichaient les oiseaux, ils les chassaient à coup de cailloux, on en a même retrouvés pendus », raconte Béatrice Ibéné, présidente de l’Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles.
Les bécasseaux maubèches, très prisées par les chasseurs, ont elles aussi vu leur population chuter. En 50 ans, leur nombre a diminué de 95%. L’espèce est désormais complètement protégée.
En 2024, l’autorisation de la chasse de certains oiseaux accordée par la préfecture avait été au coeur d’un débat, avant d’être finalement autorisée par le ministère de la Transition écologique. Et ce malgré l’inscription de certaines espèces sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature et les données qui mettaient clairement en évidence les diminutions des effectifs.
Le changement climatique aussi mis en cause
Au-delà de la chasse, les scientifiques considèrent que l’une des principales raisons de la diminution des oiseaux est le changement climatique, qui modifie leur environnement. Un phénomène est particulièrement observé dans les régions tropicales comme la Guadeloupe. Deux espèces de colibris souffrent par exemple du changement des régimes de pluie et de la disparition des insectes.
Cet été, une étude parue dans la revue scientifique Nature Ecology & Evolution expliquait que les chaleurs extrêmes liées au changement climatique avaient provoqué le déclin de 25 à 38% des effectifs d’oiseaux dans les régions tropicales entre 1950 et 2020.
Si la population des oiseaux en Guadeloupe continue d’inquiéter, il faut tout de même noter quelques avancées sur le sujet en 2025. Au mois de mars, trois arrêtés publiés par les ministères de la Transition écologique et de l’Agriculture ont mis à jour la liste des oiseaux protégés et les modalités de leur protection. 93 espèces supplémentaires ont été ajoutées, comme la colombe rouviolette et le chevalier solitaire, jusque-là autorisés à la chasse.
Toutefois, malgré la protection de davantage d’espèces, le changement climatique continuera de faire des dégâts.
Isaure Gillet