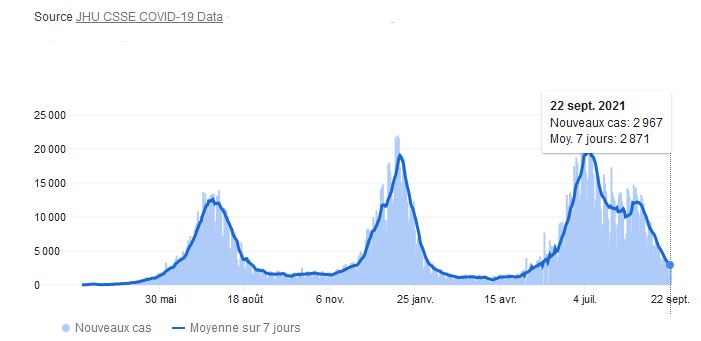Scrutin uninominal ou proportionnel, coalition des partis, élection du chancelier… On vous explique comment marchent les élections fédérales en Allemagne qui auront lieu le 26 septembre prochain.

Angela Merkel s’apprête à tirer sa révérence après seize années passées à la tête de l’Allemagne. Le 26 septembre prochain, les Allemands se rendront donc aux urnes pour élire un nouveau chancelier ou une nouvelle chancelière à la tête de leur pays ainsi que de nouveaux députés. Mais, comment ça marche, les élections allemandes ? Explications.
Commençons par les bases. La République fédérale d’Allemagne est un Etat organisé en démocratie parlementaire et composé de 16 Länder, c’est-à-dire des Etats fédéraux. Le pays est ainsi dirigé par un chancelier fédéral. Le pouvoir législatif outre-Rhin est, comme en France, exercé par deux assemblées : le Bundesrat et le Bundestag.
Pour qui s’apprêtent à voter les électeurs en Allemagne ? Ils éliront dimanche les députés du Bundestag, l’équivalent de l’Assemblée nationale en France, pour une législature de quatre ans au scrutin uninominal et proportionnel par compensation. Was ?
Deux voix pour un bulletin
Les législatives allemandes, c’est deux voix pour un bulletin : le jour du scrutin, l’électeur allemand coche donc deux cases. Dans la colonne de gauche, il doit choisir un candidat qui se présente dans sa circonscription. Celui qui arrive en tête remporte nécessairement un siège au Parlement fédéral, le Bundestag, donc. C’est la moitié des représentants allemands qui sont élus par cette voix, dite majoritaire.
Colonne de droite à présent : avec sa seconde voix, l’électeur vote cette fois-ci pour le parti de son choix avec une liste prédéfinie. Il s’agit de la même pour tout le pays. La tête de file est alors appelée à devenir chancelier ou chancelière et c’est une règle de proportionnalité qui détermine la part de sièges qui revient à chaque parti. Achtung : seuls les partis obtenant plus de 5% des suffrages à l’échelle nationale peuvent faire entrer leurs députés au Bundestag.
Coalition nécessaire
Pour gouverner, un parti doit nécessairement avoir plus de la moitié des sièges au Parlement. Mais le mode de scrutin allemand rend la chose improbable : c’est pour cela que les partis arrivés en tête des élections doivent s’allier avec un ou plusieurs autres partis. C’est ce qu’on appelle une coalition.
Les partis politiques allemands ont deux mois pour parvenir à s’entendre à compter de la date des élections. S’ils n’y parviennent pas, les élections sont annulées, s’ensuivent alors de nouvelles élections. Lorsqu’ils y arrivent, ils doivent alors s’entendre pour désigner le futur chancelier. Ce dernier se présente alors devant le nouveau Bundestag qui doit l’élire officiellement.
Qui pour succéder à Mutti (comme les citoyens allemands prénomment Angela Merkel) ? Si les sociaux-démocrates d’Olaf Scholz sont donnés gagnants dans les sondages, ils devront former une coalition avec d’autres partis. Et si une alliance avec les écologistes est plus que probable, les deux partis auront sans doute à s’unir à un autre pour obtenir une majorité. Ce serait alors la première fois en Allemagne que trois partis doivent former un gouvernement.
Lola Dhers