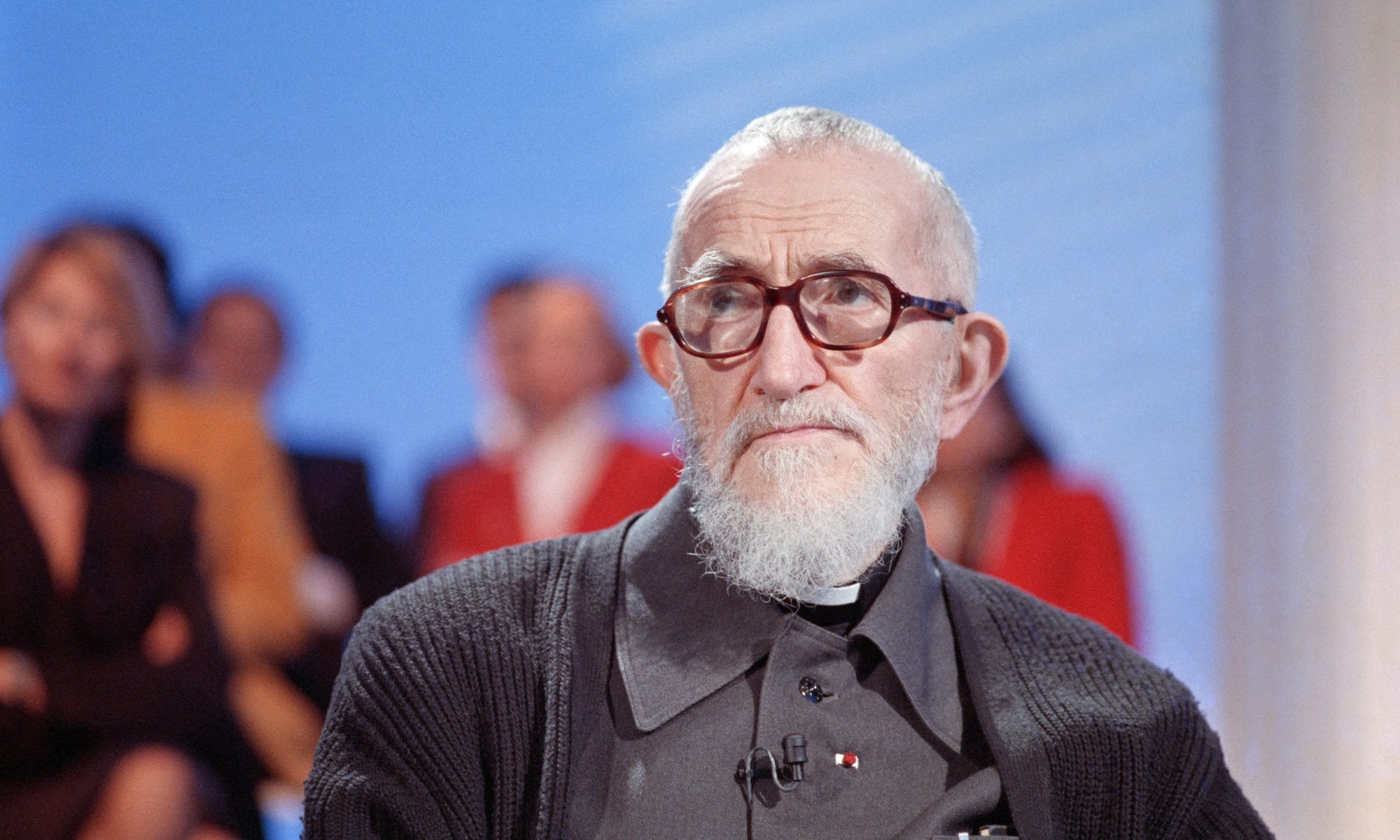Cinq personnes sont en réanimation en Indre-et-Loire après avoir consommé du pesto artisanal, un cas qui rappelle l’intoxication de dix personnes à Bordeaux en 2018 et qui avait fait un mort. Le botulisme, grave mais rare, peut pourtant être évité par des gestes simples.
Terrine de porc, sardines en conserve, pâté… et récemment pesto : les produits artisanaux peuvent conduire leurs consommateurs aux urgences s’ils n’ont pas été bien préparés. Après une mauvaise stérilisation, un aliment peut être contaminé par la bactérie Clostridium botulinum, responsable de la maladie du botulisme alimentaire. La bactérie produit des toxines neuro-toxiques, qui risquent d’entraîner une paralysie respiratoire et musculaire.
Le botulisme alimentaire peut être grave mais reste rare en France. Santé publique France recense en moyenne 14 cas déclarés chaque année. La maladie, due aux toxines crées par la bactérie de Clostridium botulinum, se distingue du botulisme infantile, causé par l’ingestion directe de la bactérie par les nourrissons. Dans tous les cas, le botulisme ne se transmet pas entre individus.
Quels sont les aliments concernés ?
Le botulisme se contracte par la consommation d’aliments qui n’ont pas été bien transformés : les produits fabriqués de manière artisanale sont donc plus susceptibles de contenir la bactérie. Le développement de la toxine botulique est due à un défaut de maîtrise du procédé de stérilisation, de salaison, et/ou à une rupture de la chaîne du froid.
Selon l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire nationale), les aliments les plus souvent impliqués sont les salaisons sèches (jambon cru), les conserves de végétaux (asperges, haricots verts, carottes et jus de carotte, poivrons, olives à la grecque, potiron, tapenade…), la viande (terrine, pâté), les plats cuisinés et le poisson salé et séché emballé sous vide.
Quels sont les symptômes ?
Le temps d’incubation de la maladie est généralement compris entre 12 et 48 heures, mais peut durer jusqu’à huit jours. Les symptômes, eux, peuvent durer de quelques jours à plusieurs mois. Leur gravité varie selon la quantité de toxines botuliques absorbée. Les premiers à apparaître sont souvent une fatigue marquée, des faiblesses (notamment dans la nuque et les bras) et des vertiges.
Il n’y a ni fièvre ni perte de conscience, mais les symptômes possibles sont nombreux : troubles digestifs (vomissements, diarrhées, constipation), atteinte oculaire (vision floue ou double, dilatement des pupilles), sécheresse dans la bouche avec des difficultés à déglutir ou à parler, et pour les formes les plus graves, une paralysie progressive des membres et des muscles respiratoires. Ces cas peuvent entraîner la mort par insuffisance respiratoire, dans moins de 5% des cas en France.
Comment soigner le botulisme ?
La lenteur du diagnostic rend le soin compliqué. En effet, l’anti-toxine botulique est un traitement efficace s’il est administré dans les 24 heures suivant les premiers symptômes. Mais la maladie étant rare, la suspicion et le diagnostic de botulisme sont souvent tardifs. Les cinq personnes suspectées de botulisme en Indre-et-Loire ne sont d’ailleurs pas encore diagnostiquées à l’heure actuelle. Les faiblesses musculaires générées par l’intoxication peuvent aussi faire penser à un AVC, un syndrome de Guillain-Barré (faiblesse musculaire) ou une myasthénie grave.
La prise en charge consiste donc principalement à traiter les symptômes. La guérison intervient sans séquelles dans la plupart des cas, mais la durée de traitement et de convalescence peut durer plusieurs mois. Une assistance respiratoire est parfois nécessaire pour les cas les plus graves. Les antibiotiques sont inutiles en cas de botulisme alimentaire car ils n’agissent pas sur les toxines.
Comment éviter la contamination ?
Il existe des bons gestes à adopter pour limiter le risque de contracter le botulisme. La vigilance est de mise car une négligence peut être lourde de conséquences.
Une hygiène irréprochable est essentielle lors de l’abattage des animaux à la ferme et lors de la préparation des viandes. Lors de la mise en conserve des aliments, il faut bien nettoyer les végétaux et utiliser des récipients et des emballages propres.
Températures, temps, nombres d’unités limitées par stérilisateur…les consignes de stérilisation doivent être appliquées à la lettre, car les spores de la bactérie résistent à l’eau bouillante.
Les boîtes de conserve bombées, déformées ou avec une odeur suspecte sont à jeter sans hésitation. De même, un bruit doit être entendu lors de l’ouverture de bocaux en verre. En l’absence d’appel d’air, le produit doit être jeté.
Pour les jambons, une bonne concentration en sel de la saumure et le respect du temps de saumurage permet d’inhiber le développement de la bactérie. La chaîne du froid est indispensable.
Pour les produits du commerce, les consignes de conservation et les dates limites de consommation doivent être suivies. Enfin, les nourrissons de moins de douze mois ne doivent pas consommer de miel, car le produit peut être contaminé par des spores de Clostridium botulinum.
Domitille Robert