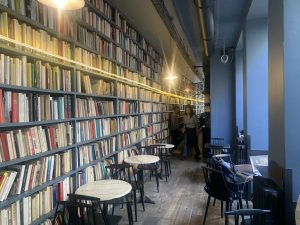La fête de l’Humanité, se tenant du 12 au 14 septembre et affichant complet pour sa 90ème édition, a été visée pour avoir programmé des artistes accusés de violences sexistes et sexuelles. Compte tenu de la portée politique de l’évènement, et tandis que les festivals sont incités à lutter contre les violences notamment via des “safe place” (stands consacrés aux minorités, notamment aux femmes), cette publication a mis le feu au poudre.
« Fête de l’Humanité, Fête des agresseurs » : c’est ainsi que le compte Instagram @militanthémis, tenu par l’étudiante en droit Sirine Sehil, a pointé le festival se tenant du 12 au 14 septembre. Pour sa 90ème édition, l’événement organisé par le journal l’Humanité affiche complet et accueille jusqu’à 110 000 visiteurs par jour.
Le 10 septembre, la publication a pris la forme d’un appel conjoint entre le compte @militanthemis de l’étudiante en droit Sirine Sehil et quatre autres comptes féministes suivis par plusieurs milliers de personnes ( @metoomedia_ , @stopfisha, @mavoixmonchoixorg, surviv_hante). Il vise quatre rappeurs : Zamdane, TIF, Kalash et Vicelow, mis en cause par des témoignages et dans le cadre d’affaires judiciaires. Un avertissement mettant le feu au poudre, notamment par la portée politique de l’évènement.
Le collectif « NousToutes » a à son tour relayé l’information le lendemain. En charge d’une safe place sur le festival (stands consacrés aux minorités, notamment aux femmes), l’organisation affirme : « Notre présence n’est pas un signe de caution. #NousToutes sera sur place pour dénoncer et offrir un soutien aux victimes dans l’Espace Safe ».
Vicelow, Kalash, TIF et Zamdane mis en cause
Comptant à ce jour plus de 27000 « j’aime », le post le @militanthemis affirme que Vicelow a été condamné par la justice pour violences conjugales envers son ex-femme, et qu’il aurait également « fait l’objet de plusieurs dénonciations de danseuses pour harcèlement et agression sexuelle ».
Concernant Kalash, les militantes reviennnent sur le livre de son ex-compagne et mère de ses enfants Ingrid Littré – Sa vérité, relatant des violences conjugales. Le rappeur avait, en réaction, porté plainte pour diffamation.
Quant à TIF , il aurait été accusé pour viol et agression sexuelle dans des Tweets supprimés depuis, les militantes déclarant qu’il « aurait apparemment fait pression sur ses victimes ».
Zamdane, pour sa part, est pointé pour banalisation du viol dans plusieurs Tweets supprimés depuis des dénonciations pour violences sexuelles à son encontre, notamment : « c’est pas du viol si elle dort ».
En commentaires, la publication fait débat : de nombreux internautes soutiennent et s’indignent, d’autres s’interrogent sur le fait que les artistes mis en cause soient uniquement des rappeurs et personnes racisées, ce à quoi les comptes à son initiative répondent être des « femmes racisées queer » également engagées sur ce sujet.
« Déjà l’année dernière, nous avons bataillé pour faire retirer le concert de Heuss l’Enfoiré », déclarent-elles, ajoutant que le festival « les ignorait ».
« Silence radio » du côté de la direction de l’organisation du festival
Cette année encore, « silence radio » du côté de la fête de l’Humanité, relève @stopfisha : « Nous avons tout essayé pour discuter avec la directrice, sans résultat ». Les autrices de la publication déclarent avoir contacté l’un des organisateurs à propos de Vicelow dès le 10 juin, ce dernier disant « se renseigner », mais n’étant jamais revenu vers elles : « 3 mois après, il ne l’a pas fait ».
Néanmoins « la rédaction du journal l’Humanité a été avec nous », indique Hajar, co-gérante du compte @stopfisha. » Ils nous ont accordé du temps, on leur a apporté les preuves et ils en ont été horrifié. Cela fait six mois que des personnes du festival essaient de faire déprogrammer des artistes, mais la direction ne donne pas suite ». « C’est pratique d’avoir des associations féministes sur place lorsqu’elles paient les stands, mais pas lorsqu’il s’agit de mettre la main au portefeuille et d’agir” dénonce-t-elle.
Sur place, « plusieurs militantes féministes ont décidé de mener des actions », notamment « concernant le concert de Kalash, qui n’a pas été déprogrammé », indique encore la militante.
Contactée concernant la publication, l’organisation du festival n’a pas donné suite.
« On sait pertinemment que c’est des agresseurs » : la déception des festivaliers
Au-delà des réseaux, cette alerte interpelle les festivaliers se rendant actuellement sur le site de Brétigny-sur-Orge et du Plessis-Pâté pour assister à l’évènement. Nombreux sont ceux l’ayant découvert tardivement . Pour Inès, 25 ans, le déclencheur a été la raillerie d’un ami : « je n’ai pas compris pourquoi il nous disait qu’on faisait partie de la gauche « deux poids, deux mesures » car je n’en avais pas pris connaissance, c’est là qu’il nous a montré le post ».
Maintenant qu’elle a sa place, Inès s’y rend mais ne cache pas son exaspération quant à la scission entre les « valeurs de gauche » représentées par cet évènement, et le fait que le festival « invite des mecs dont on sait pertinemment que c’est des agresseurs ». La jeune femme pointe particulièrement Kalash, ne connaissant pas les autres artistes mais soulignant qu’elle avait « eu des échos » concernant les affaires impliquant cet artiste.
« Il est hors de question que je mette les pieds à leurs concerts », souligne t-elle tout en regrettant que ce problème concerne de nombreux festivals : « on entend parler de plus en plus de festivals qui programment des agresseurs, mais habituellement c’est fait un peu en amont et le festival est exposé et contraint de régler ce problème ».
« Ce n’est pas la première fois qu’un festival est accusé de programmer des artistes qui font l’objet de ce genre d’accusations. J’ai l’impression que c’est un peu banal de les programmer malgré tout », la rejoint Anna, 23 ans. La jeune femme se rend à cet évènement pour la première fois, découvrant que sa portée dépassant le simple festival de musique : « j’ai réalisé à quelle point sa dimension politique était forte, notamment avec tous les stands des sections du PCF », « c’est vrai qu’un festival avec une dimension politique aussi forte devrait être exemplaire sur la programmation des artistes » conclue-t-elle.
« J’ai été surpris et j’ai ressenti une certaine déception », explique quant à lui Lucas, 25 ans, dont cet évènement « ne change pas l’idée globale du festival » mais qui regrette un « manque de rigueur » dans l’organisation : « beaucoup d’autres artistes auraient pu être choisis, pour les faire monter, plutôt que des agresseurs ».
Quelles répercussions sur le festival ?
Le concert de TIF a été annulé et remplacé par un concert « en solidarité avec le peuple Palestinien », l’artiste ayant annoncé le 8 septembre « qu’il ne serait finalement pas présent à la fête de l’Humanité », comme l’explique une publication du festival, sans en avancer les raisons. Les trois autres rappeurs n’ont pour leur part pas été déprogrammés.
Sur place, Zamdane s’est exprimé sur ses accusation au début de son concert, déclarant qu’il regrettait ses tweets et exprimant « force et soutien pour toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles ». Le rappeur a également annoncé porter plainte pour diffamation sur Instagram le vendredi 12 septembre.
En parallèle, des internautes continuent à interpeller le festival sous chacune de ses publications Instagram : « Kalash est un mec qui a battu son ex, […] vicelow a été condamné par la justice », « Pourquoi autant d’agresseurs en tête d’affiche »?