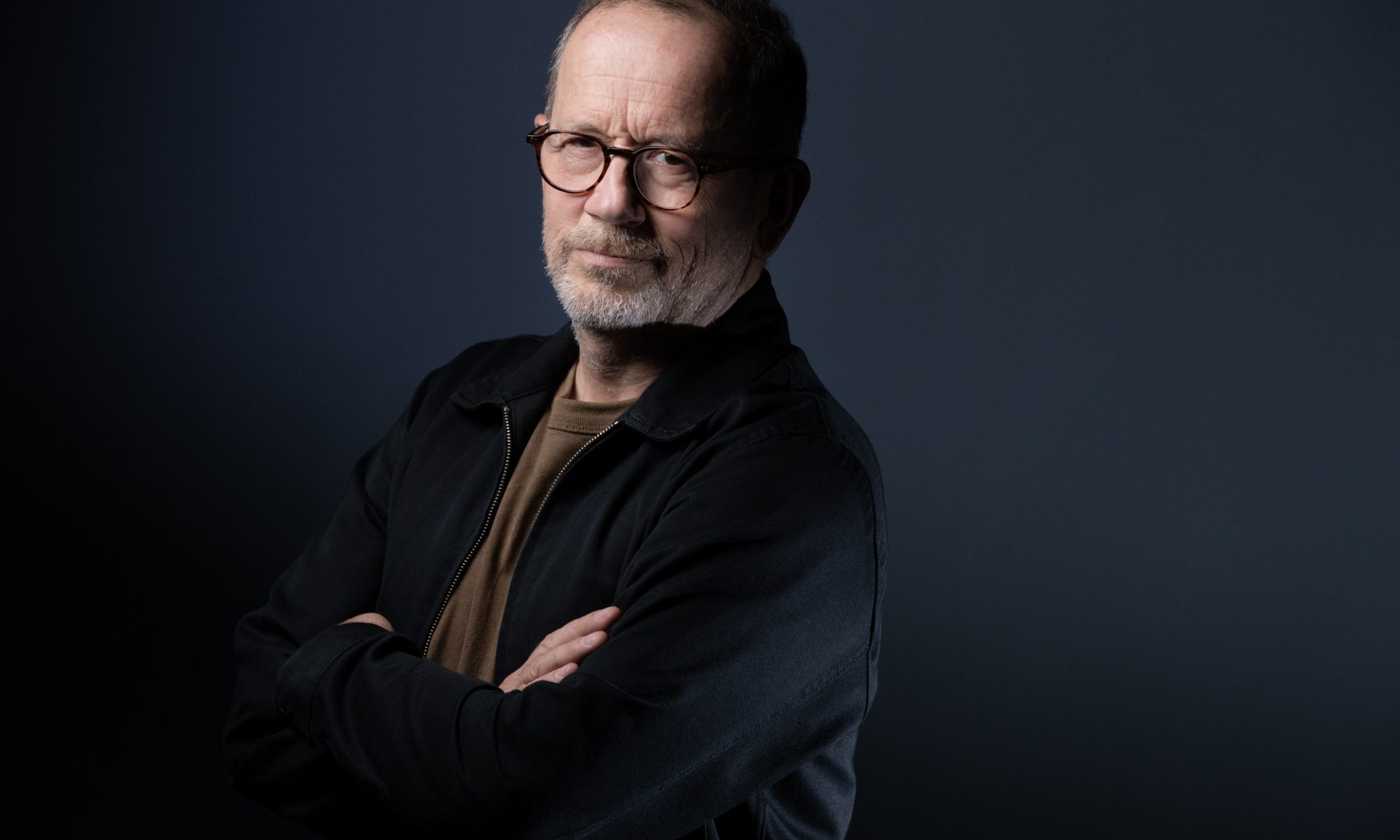La dernière enquête ESPAD relève une diminution significative de la consommation de substances psychoactives, légales ou non, chez les jeunes de 16 ans en France. Changements des représentations sociales, moins de sorties, autres alternatives : plusieurs raisons expliquent cette tendance.
Pour beaucoup, qui dit adolescence dit premières soirées, et dit donc premières cigarettes, premiers verres alcoolisés ou premiers joints. Pourtant, la nouvelle enquête European School Survey Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD) publiée ce jeudi 11 septembre au matin, dément ce cliché : la consommation de substances psychoactives diminue de manière significative chez les adolescents.
Dans cette nouvelle édition de l’enquête ESPAD, réalisée tous les quatre ans dans 37 pays d’Europe pour étudier la consommation de substances psychoactives des jeunes de 16 ans, la France se démarque particulièrement : dans toutes les catégories – tabac, alcool, cannabis et autres drogues illicites – le pays se situe désormais en dessous de la moyenne européenne et enregistre l’une des baisses les plus nettes de la dernière décennie.
« Moins d’opportunité d’en consommer »
Ce phénomène en France s’explique par la combinaison de plusieurs facteurs. Tout d’abord, Ivana Obradovic, directrice adjointe de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives, mentionne la diminution des opportunités par un changement des sociabilités : « Moins de sorties dans les nouvelles générations d’adolescents, moins d’opportunités d’en consommer, parce que c’est souvent au moment des sorties dans les bars et en soirées qu’on consomme de l’alcool ou du cannabis », expose-t-elle à Franceinfo. Une diminution des soirées qui s’explique, entre autres, par les réseaux sociaux qui rendent les jeunes plus casaniers.
Concernant le tabac, il est de moins en moins normalisé par les jeunes générations : avec les campagnes de sensibilisation menées dans le pays, beaucoup ont conscience de sa dangerosité. On observe par ailleurs un comportement vertueux chez les parents, qui ont tendance à moins fumer devant leurs enfants. Le constat est le même avec la consommation d’alcool.
Il faut néanmoins relever que les adolescents ont d’autres alternatives à ces substances. Par exemple, si les expérimentateurs de tabac sont de plus en plus rares, les Français de 16 ans sont nombreux à avoir testé au moins une fois la cigarette électronique.
Le tabac et le cannabis en nette baisse
Parmi toutes les substances psychoactives étudiées à travers l’enquête ESPAD, ce sont le tabac et le cannabis qui connaissent la diminution la plus spectaculaire chez les Français. Selon l’enquête ESPAD, 20% des adolescents de 16 ans ont expérimenté le premier en 2024 – l’une des plus faibles données d’Europe – et la part de fumeurs quotidiens de cigarettes a été divisée par cinq en dix ans : ils étaient 3,1% en 2024, pour environ 16% en 2015.
Quant au cannabis, après avoir longtemps été l’un des pays où cette drogue était le plus consommé, la France est désormais parmi ceux où les jeunes l’expérimentent le moins : 8,4 % l’avaient testé en 2024, contre 31 % en 2015. Une chute significative, qui l’est encore plus quand on sait que de nombreux pays européens voient leurs données stagner pour cet indicateur.
Reste maintenant à savoir si cette génération consommera moins que ses aînés à l’âge adulte, alors que la prise de certaines drogues illicites, comme la cocaïne, augmente en France.
Isaure Gillet