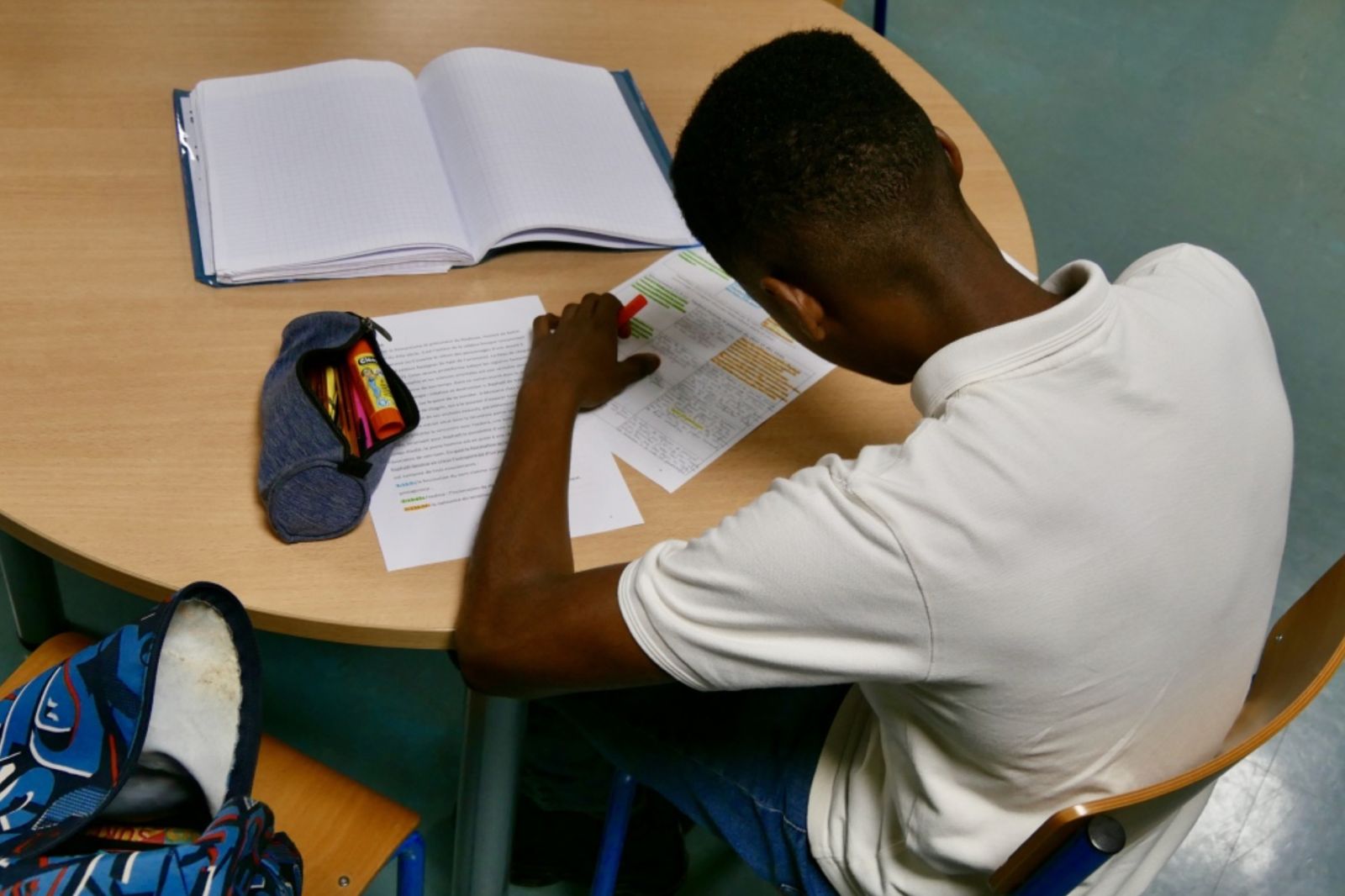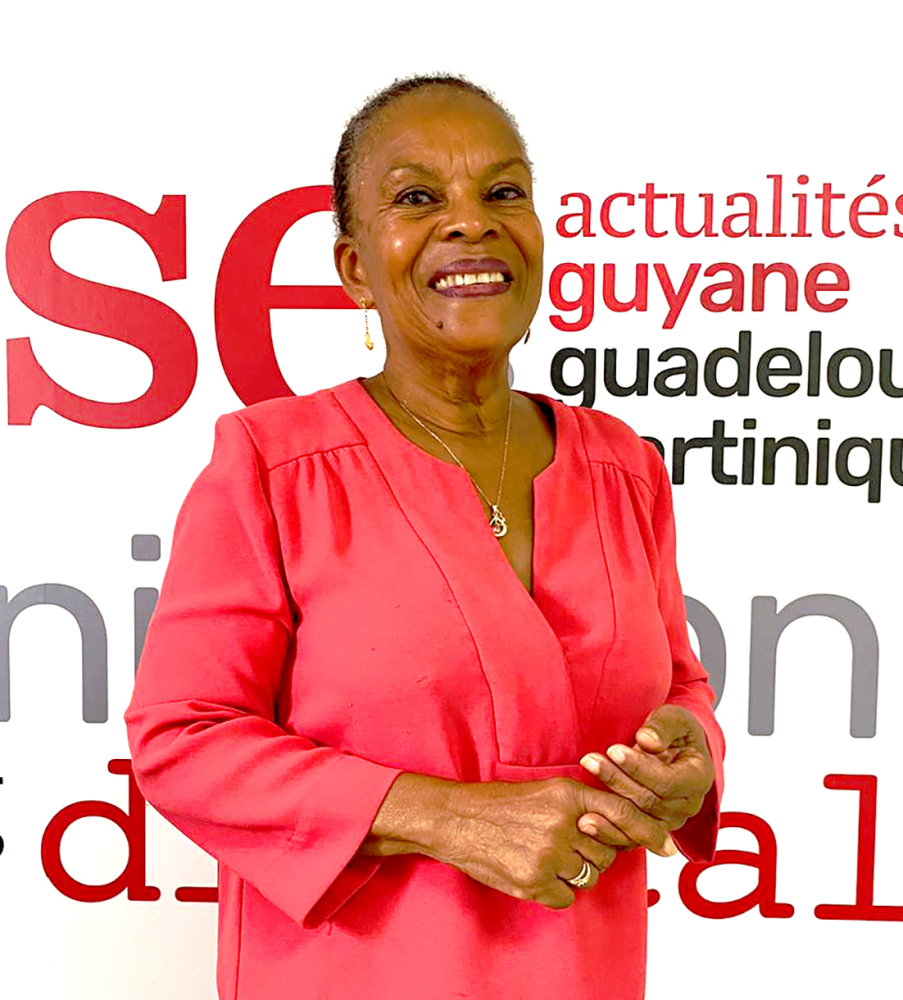Avec quelque 4 500 étudiants inscrits chaque année, l’Université des Antilles reste le principal acteur de l’enseignement supérieur en Martinique. Sur le campus, les filières généralistes — lettres, droit, sciences humaines, économie ou biologie — structurent une offre académique classique. À cette base s’ajoutent des formations plus professionnalisantes, proposées notamment à l’IUT avec des BUT en informatique, logistique ou gestion des entreprises.
Dans le champ de la santé, la filière médecine attire un nombre croissant d’étudiants, avec environ 200 places proposées. Mais comme pour d’autres disciplines, le parcours reste partiel : au-delà des premières années, les étudiants doivent poursuivre leur cursus en Guadeloupe ou en métropole. Même contrainte pour les études de pharmacie ou de kinésithérapie, inexistantes localement.
L’université dispose également d’un pôle de formation aux concours de l’enseignement, avec des préparations aux concours du professorat des écoles, du CAPES ou de l’agrégation. Elle développe par ailleurs des partenariats à l’international, notamment via le programme Erasmus+, offrant aux étudiants des possibilités de mobilité en Europe ou aux États-Unis.
Malgré ces évolutions, l’offre reste insuffisante pour répondre à la diversité des aspirations étudiantes. Faute de masters spécialisés, d’écoles intégrées ou de filières dans le domaine de l’ingénierie, des arts ou des sciences politiques, plusieurs centaines de bacheliers quittent chaque année le territoire pour poursuivre leurs études ailleurs. Un départ souvent présenté comme provisoire, mais qui s’inscrit dans un phénomène de mobilité durable, voire définitive, faute de conditions suffisantes de retour.