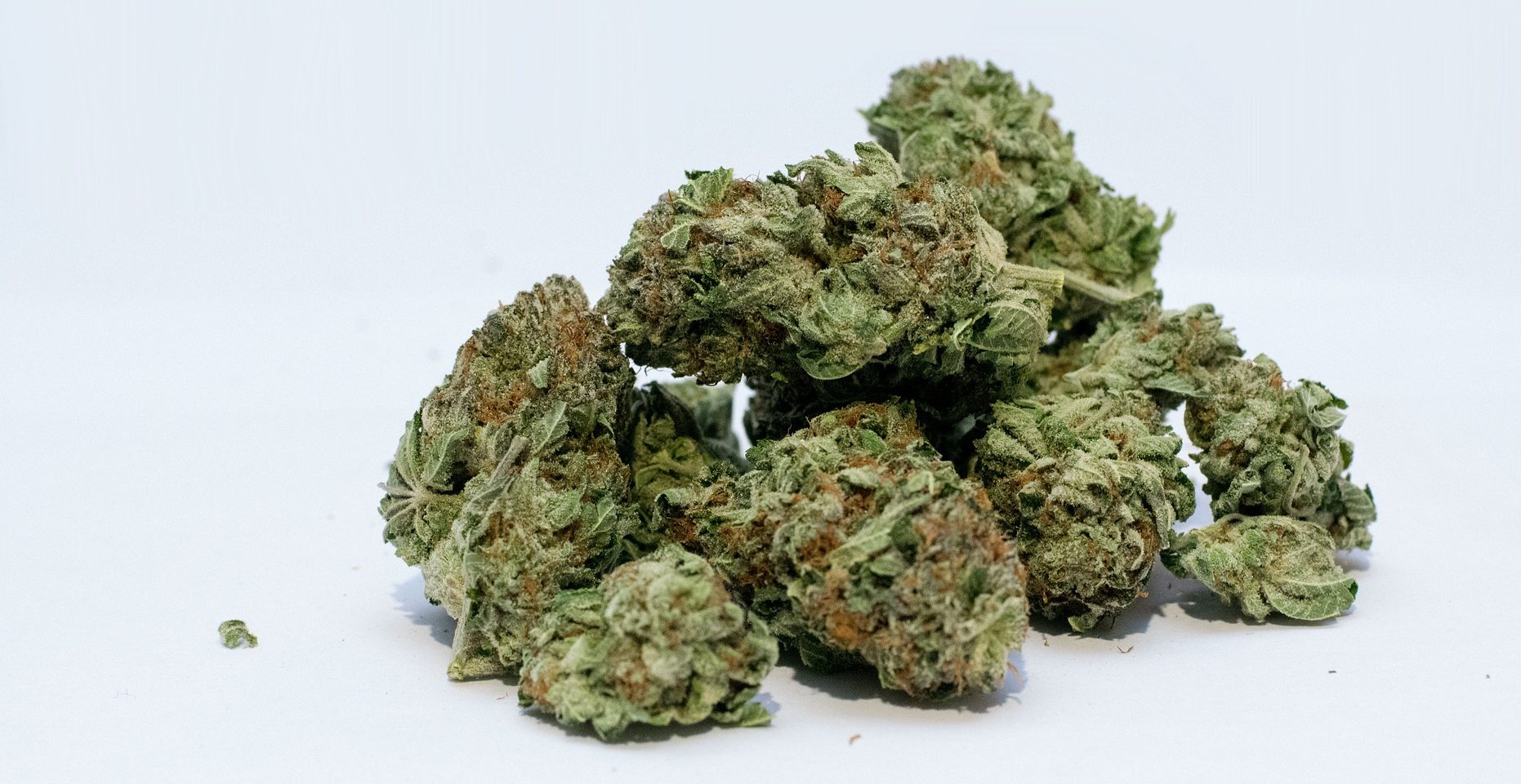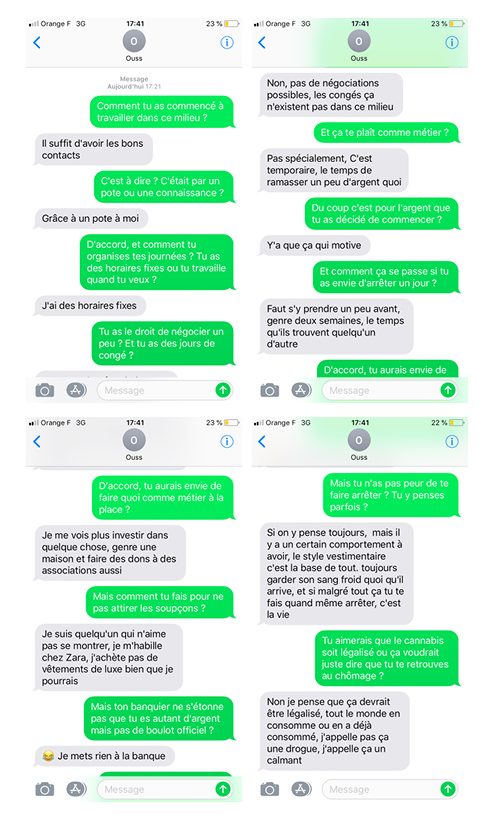Ils appelaient à vider leurs comptes et à ne payer qu’en liquide. Ce mardi 10 septembre, les partisans du mouvement « au cash citoyen » espéraient pénaliser les banques. Mais l’opération n’a entraîné aucun impact visible sur l’économie.

Le mot d’ordre a circulé dès le mois d’août sur les réseaux sociaux : cesser d’utiliser la carte bancaire pendant vingt-quatre heures et retirer son argent des comptes, afin de priver les établissements financiers des revenus liés aux transactions. En marge du mouvement social national « bloquons tout » de ce mardi 10 septembre, l’opération se voulait une alternative aux cortèges et aux blocages, avec l’idée de cibler directement le système bancaire. Rarement utilisée dans l’histoire des mobilisations sociales, cette stratégie devait démontrer qu’un boycott massif des cartes pouvait priver les banques de ressources.
Dès le lancement, les limites apparaissaient pourtant clairement. « Le pire risque qu’on puisse courir, c’est que les distributeurs soient vidés plus rapidement que d’ordinaire », explique Philippe Moati, professeur d’économie à l’Université Paris-Diderot et cofondateur de l’Observatoire Societe et Consommation (ObSoCo). Mais une telle situation ne se serait produit que si la mobilisation avait atteint une ampleur nationale. « Force est de constater que ça n’a pas été le cas », martèle l’économiste.
Un phénomène de « bank run » ?
Les initiateurs du boycott s’appuyaient sur un constat réel : la carte bancaire occupe désormais une place centrale dans les habitudes de consommation. En 2024, la Banque de France enregistrait 824 milliards d’euros de dépenses réglées par carte, soit près de 68 milliards par mois. Chaque transaction génère une commission dite d’interchange, versée par la banque du commerçant à celle du client, censée couvrir le risque et les coûts de gestion. Les militants estimaient que la suppression de ces commissions pendant une journée pouvait priver les établissements financiers de milliards d’euros. C’est notamment pour cette raison que certains restaurateurs offraient une réduction aux clients réglant en espèces ce mardi.
10 septembre: ces restaurants qui appellent à boycotter la carte bancaire pic.twitter.com/deEESKNQAn
— BFMTV (@BFMTV) September 9, 2025
Mais la réalité est plus nuancée. Ces commissions représentent en moyenne 0,5 % de la transaction, et non les 2 % souvent avancés. Rapportées au volume annuel des paiements par carte, elles représentent environ 60 millions d’euros. Une somme très éloignée des seize milliards évoqués par certains internautes. « Pour avoir un impact réel, il faudrait que le mouvement se répète, qu’il dure dans le temps et qu’il soit très suivi », note Philippe Moati. « Une seule journée, ne change pas la donne pour les banques. Je ne pense même pas qu’elles s’étaient particulièrement préparées ».
Quant à l’idée de retirer massivement son argent, elle aurait pu poser un problème d’un autre ordre. Un retrait généralisé créerait un « bank run », phénomène déjà observé dans l’histoire économique, notamment en 2008 lors de la crise des subprimes, et toujours redouté. « Si tous les déposants voulaient vider leur compte en même temps, cela créerait des difficultés », confirme Philippe Moati. Puis de préciser aussitôt : « Ce n’est absolument pas ce que l’on observe aujourd’hui. » Aucun signe de retraits massifs n’a été constaté ce mardi. Plusieurs supermarchés interrogés indiquent qu’ils n’ont constaté aucune différence avec une journée habituelle, ni dans le nombre de paiements en liquide ni dans la fréquentation. Des efforts stérile donc, et plutôt symboliques pour les citoyens mobilisés ce mardi.
Romanée Ducherpozat