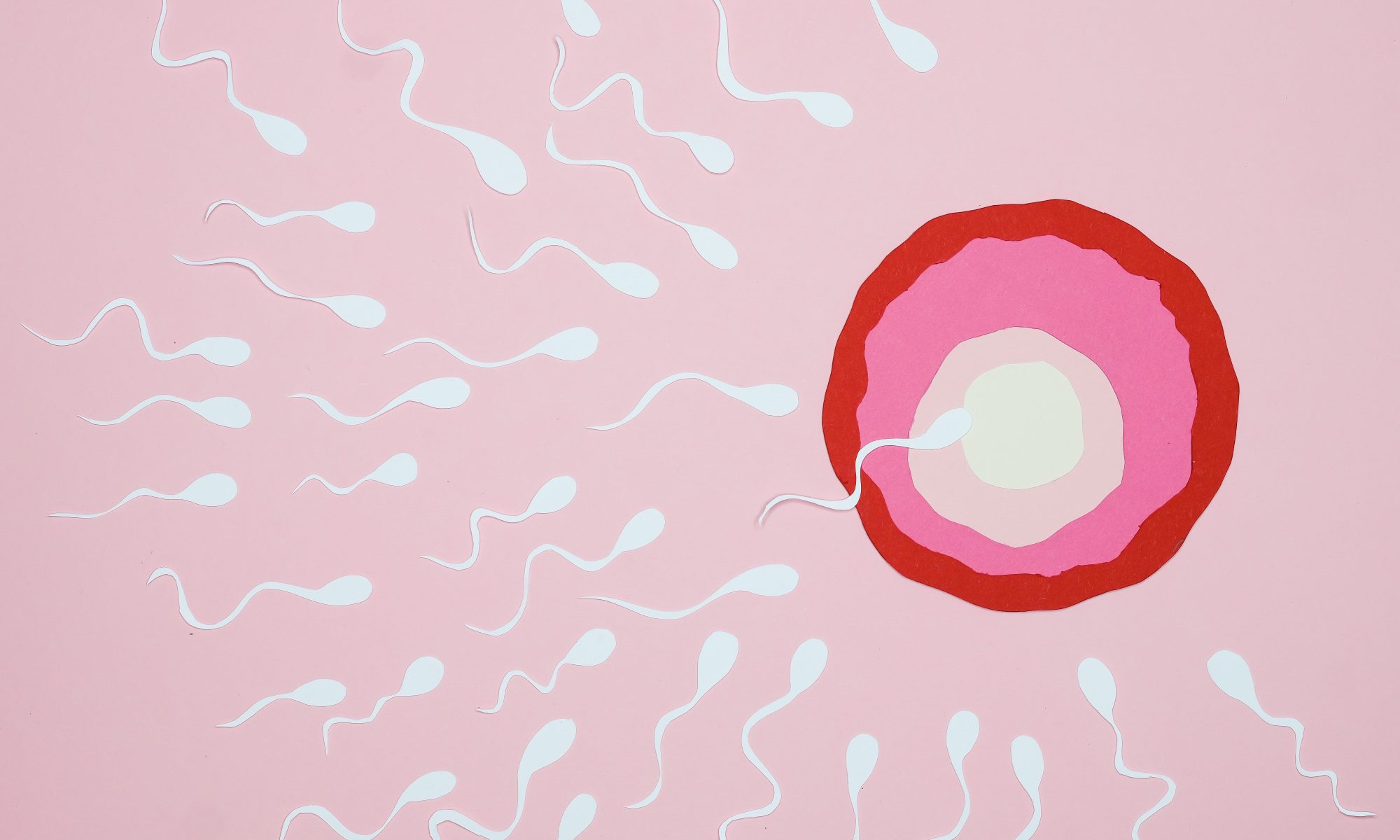Sur TikTok, #Ozempic cumule des centaines de millions de vues. Les vidéos « avant/après » de perte de poids se multiplient, incitant de plus en plus de jeunes à détourner ces traitements destinés au diabète ou à l’obésité sévère en produits tendance. Face à la prolifération de ventes illégales en ligne, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a saisi, jeudi 11 septembre la justice et alerte sur les dangers d’un phénomène qui prend de l’ampleur.
L’Ozempic est un antidiabétique dont l’usage a été détourné en produit amaigrissant ©
Sur Instagram et TikTok, impossible d’y échapper. Le #Ozempic s’affiche sous des vidéos cumulant des millions de vues : jeunes femmes exhibant une perte de poids spectaculaire, témoignages enthousiastes, conseils pour se procurer le produit sans passer par un médecin. Certaines vidéos atteignent plusieurs centaines de milliers de partages, donnant l’impression que ce médicament est devenu un simple allié minceur.
Une banalisation qui inquiète les autorités. Car derrière ce succès numérique se cache un usage massif et illégal de traitements à base d’aGLP-1, tels qu’Ozempic, Wegovy ou Mounjaro, qui ne devraient être prescrits qu’aux patients atteints de diabète de type 2 ou d’obésité sévère. « La vente et la promotion sans autorisation de médicaments aGLP-A sur internet est illégale. Les produits vendus peuvent être contrefaits et mettre en danger la santé des personnes qui les utilisent », rappelle l’ANSM, qui a déjà saisi le procureur de la République et signalé une dizaine de sites au portail Pharos du ministère de l’Intérieur.
« Ce ne sont pas des produits miracles, mais des traitements lourds »
Derrière l’écran des réseaux sociaux, les risques sont bien réels. Le docteur Assad, endocrinologue à Paris, insiste sur la dangerosité de ces détournements. « Ce ne sont pas des produits miracles. Ce sont des traitements lourds, qui modifient l’équilibre hormonal et digestif du patient. Pris sans suivi médical, ils peuvent provoquer des nausées sévères, des pancréatites, voire des troubles cardiaques ».
Sur TikTok, une tendance baptisée « Ozempic Face » illustre déjà certains effets indésirables : visages émaciés et rides creusées par une perte trop rapide de la graisse. « Ce phénomène est le signe que le corps est malmené par une perte de poids brutale. Il ne faut pas sous-estimer les conséquences à long terme, car nous manquons encore de recul sur les effets secondaires », prévient le médecin.
Le parallèle avec le scandale du Médiator, révélé en 2010, s’impose. Ce médicament, initialement prescrit aux diabétiques mais détourné comme coupe-faim, a entraîné entre 500 et 2 000 décès. « L’histoire nous rappelle combien les détournements de médicaments peuvent être tragiques », souligne le docteur Assad.
Une course à la minceur qui inquiète les autorités sanitaires
Si l’attrait pour ces traitements explose, c’est parce qu’ils promettent une perte de poids rapide et sans effort. Mais cette illusion d’efficacité séduit particulièrement les jeunes femmes, vulnérables aux injections sociales relayées par les réseaux. « L’effet de mode autour de ces médicaments est préoccupant. Il banalise un produit qui doit rester un traitement encadré médicalement, et non une solution esthétique », souligne un médecin généraliste et esthétique.
Pour endiguer le phénomène, l’agence nationale de sécurité du médicament multiplie les actions : saisines judiciaires, fermetures de sites, travail avec les plateformes de vente en ligne pour interdire toute publicité. Mais la viralité des réseaux sociaux rend la tâche complexe. « Les jeunes trouvent toujours des moyens de contourner les interdictions », admet ce même médecin toulousain.
Face à cette dérive, médecins et autorités appellent à la vigilance. Le docteur conclut : « Derrière chaque stylo injecteur acheté sur internet, il y a un risque sanitaire majeur. Les patients doivent comprendre qu’on ne joue pas avec ces traitements comme on testerait un régime à la mode ».
Ava Ouaknine