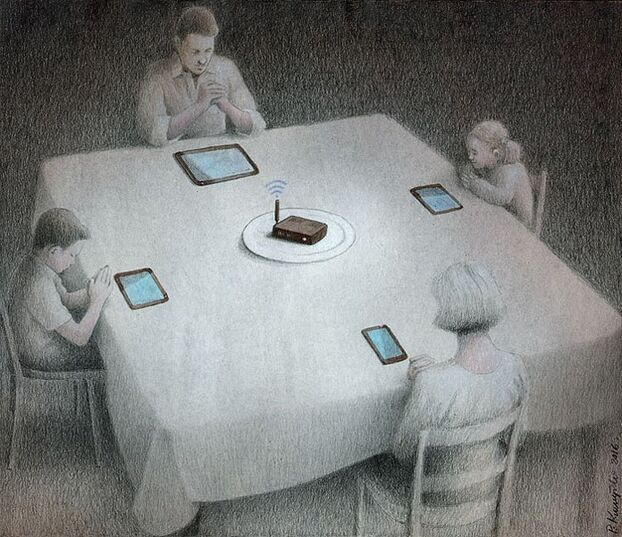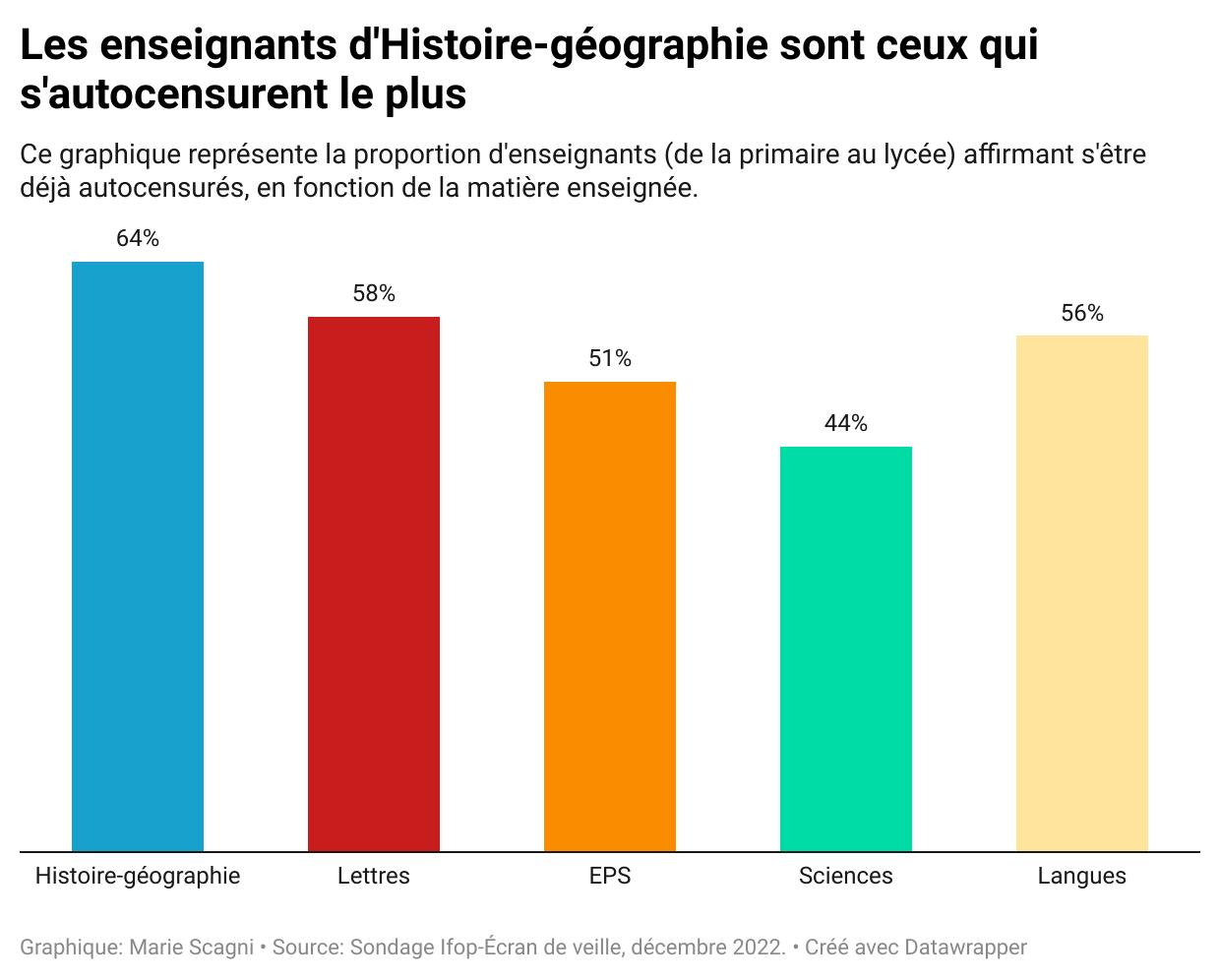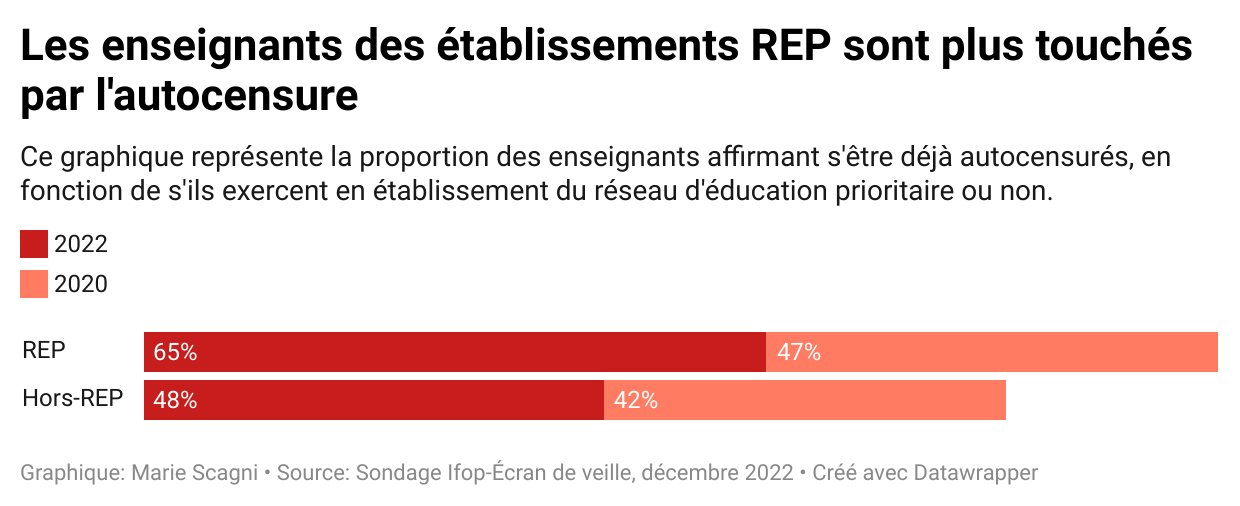L’été arrive à grands pas. Festivals, concerts, soirées en plein air, verres en terrasse : les occasions festives se multiplient avec l’arrivée des beaux jours tout comme, les risques liés à soumission chimique. Tour d’horizon des bons réflexes pour profiter des festivités à venir en toute sérénité.

Crédits : Photo d’illustration Sipa/Syspeo
Selon l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), la « soumission chimique désigne l’administration d’une substance psychoactive à une personne, sans qu’elle en ait connaissance ou sous la contrainte, dans le but de commettre un délit ou un crime, comme un vol, une agression sexuelle, un viol.»
Il s’agit souvent d’un médicament détourné de son usage médical (antihistaminique, sédatif, anxiolytique, antidépresseur), ou non médicamenteuse de type drogue (MDMA, cocaïne, 3-MMC, GHB, alcool). La substance est ajoutée dans une boisson, de la nourriture, ou injectée avec une seringue.
Ces actes malveillants, punis par la loi, touchent majoritairement les femmes. D’après l’ANSM, sur les 97 signalements de soumission chimique en 2022, 80 étaient des femmes soit 82.5% des cas. À noter que la soumission chimique, peut toucher tout le monde, sans distinction d’âge ni de genre.
Les symptômes apparaissent quelques minutes voire quelques heures plus tard. Pour réagir rapidement, il est important d’apprendre à les connaître. Pour certains, la mémoire peut être affectée. Ils peuvent souffrir d’une amnésie totale ou partielle, ce sont les signes connus communément comme les « trous noirs ». D’autres, peuvent ressentir une fatigue intense, des vertiges, un état de somnolence, des vomissements, une perte de poids ou de cheveux, ou encore, des signes de violences inexpliqués.
Si ces symptômes peuvent sembler assez communs, il faut surtout s’inquiéter lorsqu’ils surviennent de façon inexpliquée ou après une soirée animée.
Voir cette publication sur Instagram
Les bons gestes et réflexes à adopter
Premier conseil : agir rapidement. Dès le moindre symptôme pouvant être associé à la soumission chimique, chez vous ou dans votre entourage, il faut immédiatement consulter un médecin. Il prescrira des analyses toxicologiques ou une exploration corporelle si un viol ou des coups sont suspectés.
Il est recommandé de ne pas prendre de douche, et de ne pas attendre plusieurs jours. Après un temps trop long, les substances ne sont pas détectables. Si la personne est dans une condition physique dégradée, il faut immédiatement appeler le 18 ou le 15. Dans le cas où les faits sont médicalement avérés, il est hautement conseillé de porter plainte.
Par ailleurs, informer ses proches de son lieu de sortie et de vos accompagnants, ne jamais laisser son verre sans surveillance et éviter de consommer des boissons suspectes est aussi préconisé.
Des dispositifs « anti-soumission chimique »
En France, en novembre 2024, une expérimentation concernant des kits d’auto-détection de « soumission chimique » ou de « dépistage du lendemain » a été menée dans plusieurs départements français. Remboursés par l’assurance maladie et vendus en officines ou dans certains laboratoires, ils contenaient des flacons pour recueillir l’urine et des adresses utiles comportant la démarche pour les victimes.
Dans plusieurs lieux festifs, des bâtonnets à tremper dans les boissons sont distribués afin que chacun puisse détecter de potentiels substances suspectes dans leur verre. Du côté de l’Espagne, des bracelets anti soumissions chimiques ont été déployées lors des festivals. Le fonctionnement est simple, le bracelet contient deux carré protégés par un film plastique. Il suffit de retirer ce film et de déposer une à deux gouttes de la boisson à tester. Le carré change d’aspect. Selon un code couleur marqué sur le bracelet, l’utilisateur est averti ou non du potentiel risque présenté par sa boisson.
Cependant, la fiabilité de ces dispositifs fait débat. La mesure des kits du lendemain a été abandonnée en France et ne figure pas dans la cinquantaine de proposition pour combler les lacunes de prévention remis ce lundi 12 mai au gouvernement par la mission parlementaire sur la soumission chimique. Plusieurs associations sensibilisent à ce problème et proposent une aide aux victimes.
Ana Escapil-Inchauspé