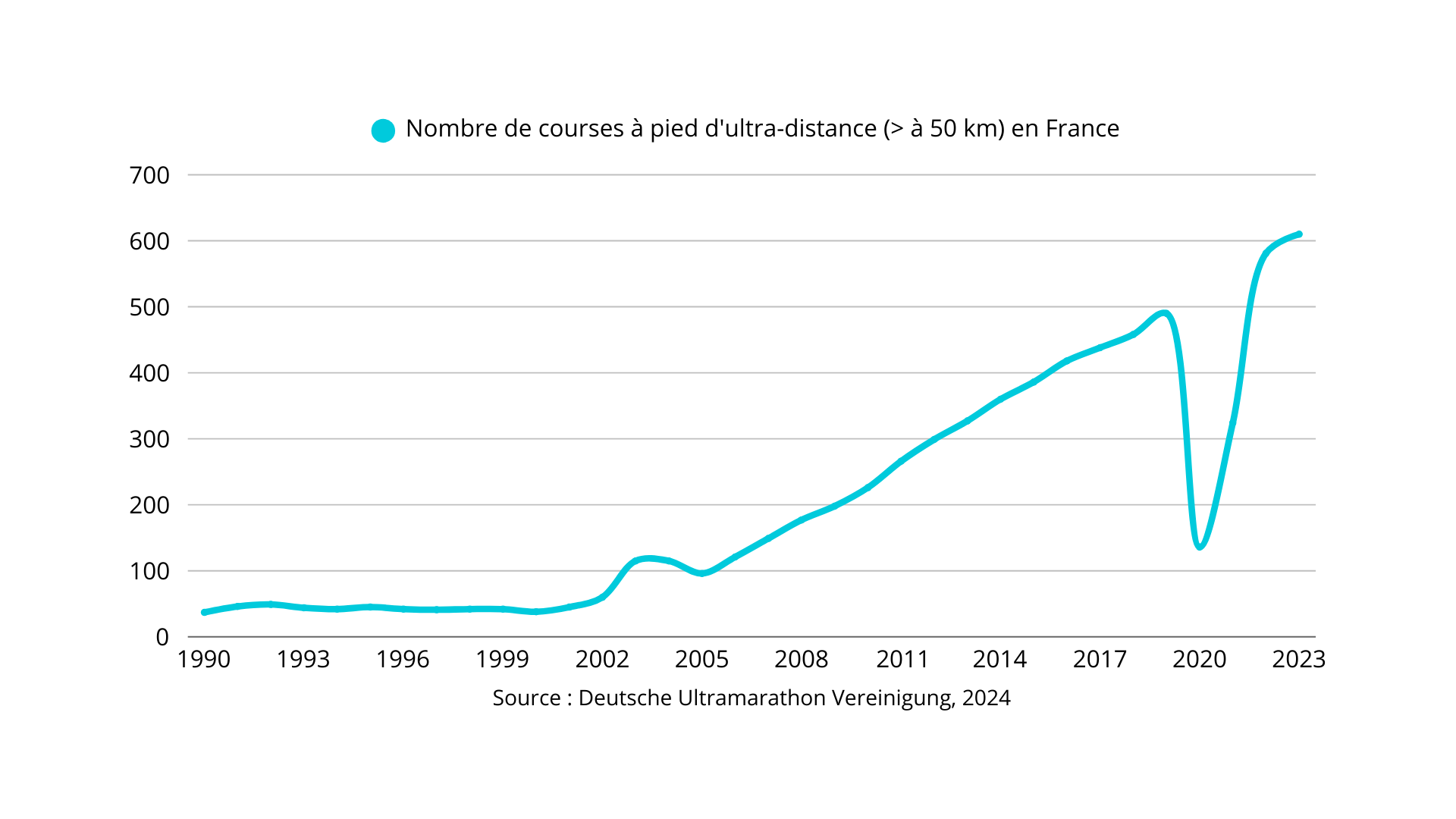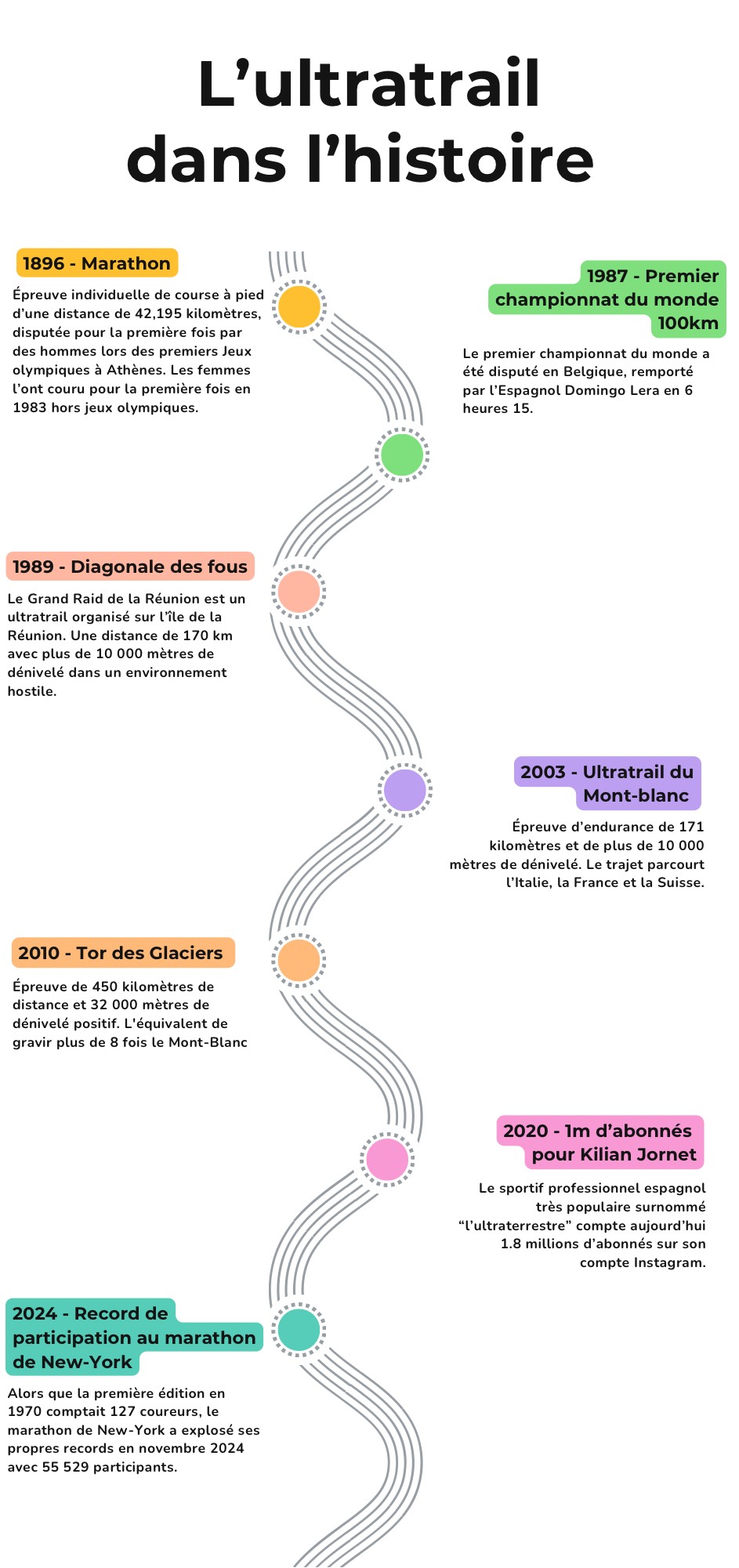L’ultra-distance est pour d’autres un véritable mode de vie et le moyen de fuir une routine. « Il y a une forme d’addiction car on échappe aux tensions du quotidien et on cherche à recréer sans cesse l’état de plénitude généré après l’effort », reconnaît Bertrand Loubeyre.
Avocat de profession, l’homme de 55 ans pratique la course à pied et le vélo depuis des années. À 40 ans, désireux d’explorer davantage ces disciplines, Bertrand Loubeyre se fixe un nouvel objectif : boucler un triathlon.
Pour y parvenir, il s’inscrit dans un club et réorganise toute sa vie autour de sa préparation. Le coureur achève son premier Ironman en 2015, aux Pays-Bas. Un exploit qu’il réalise une seconde fois deux ans plus tard, à Zurich.
Comme beaucoup d’adeptes de sports extrêmes, il se laisse happer par l’envie constante de se dépasser. « Ça occupait mes pensées, mes nuits, mon alimentation… C’est agréable car on mène une vie saine, mais c’est aussi un mode de vie très égoïste », admet-il. Son temps libre est alors consacré à la performance, au détriment de tout le reste. « On ne pense qu’à ça, plus qu’à son boulot, plus qu’à son couple. Mon épouse et moi nous sommes séparés en partie à cause de ça », confie Bertrand Loubeyre à demi-mot.
Mais en 2017, les médecins lui diagnostiquent un cancer. Après une chimiothérapie éprouvante, toute une vie d’efforts s’effondre et l’avocat vit douloureusement cet abandon forcé. « Je passais d’une hypersanté à une hypermaladie sans aucune transition », raconte-t-il avec émotion. Depuis sa guérison, il n’a jamais souhaité reprendre le sport à un tel niveau.
Le parcours de l’avocat illustre à quel point la pratique de l’ultra-distance peut devenir une addiction. Chez de nombreux coureurs, l’organisation du quotidien gravite autour de l’entraînement et des objectifs à atteindre. Ainsi, l’abandon, qu’il soit volontaire ou imposé par des circonstances extérieures, peut être ressenti comme un véritable échec personnel.
« On ne pense qu’à ça, plus qu’à son boulot, plus qu’à son couple »
Malo Le Fur a lui aussi été confronté à l’épreuve de l’abandon. Victime d’une inflammation à la cuisse après une course, il n’a pas pu achever la suivante, longue de 80 km. « À ce moment-là, mentalement c’est vraiment dur », reconnaît-il. Des signaux d’alerte envoyés par son corps que le journaliste ignore délibérément. « J’ai du mal à doser en intensité car l’effort me procure tellement de plaisir que je verrai plus tard pour les conséquences », explique-t-il en se comparant à un fumeur incapable de renoncer à la cigarette malgré les dangers.
Des sportifs qui en veulent toujours plus
À seulement 22 ans, Malo Le Fur fait partie de cette génération de coureurs débutants en quête de défis hors normes. Il a commencé la course à pied il y a à peine deux ans et demi, pour surmonter le deuil de son père. Peu de temps après, il termine un marathon, quasiment sans préparation.
Le jeune sportif enchaîne ensuite les courses longs formats. En avril, il court 250 km dans le Sahara en six jours, lors du Marathon des Sables, dans l’objectif de tester ses limites. « Je voulais atteindre ce moment de craquage mental, mais au milieu du désert, tu n’as aucun moyen d’abandonner, tu es obligé de te dépasser », se remémore Malo Le Fur.
Malgré ces prouesses sportives, l’insatiable coureur se fixe des objectifs toujours plus ambitieux. Parmi eux, le Trail du Saint-Jacques, en Haute-Loire, une course sans arrêt de 134 km. Le sportif espère aussi relier Marseille à San Pellegrino, dans le nord de l’Italie, cet été. Un périple de plus de 500 km motivé par l’unique désir d’atteindre la source de son eau gazeuse préférée.