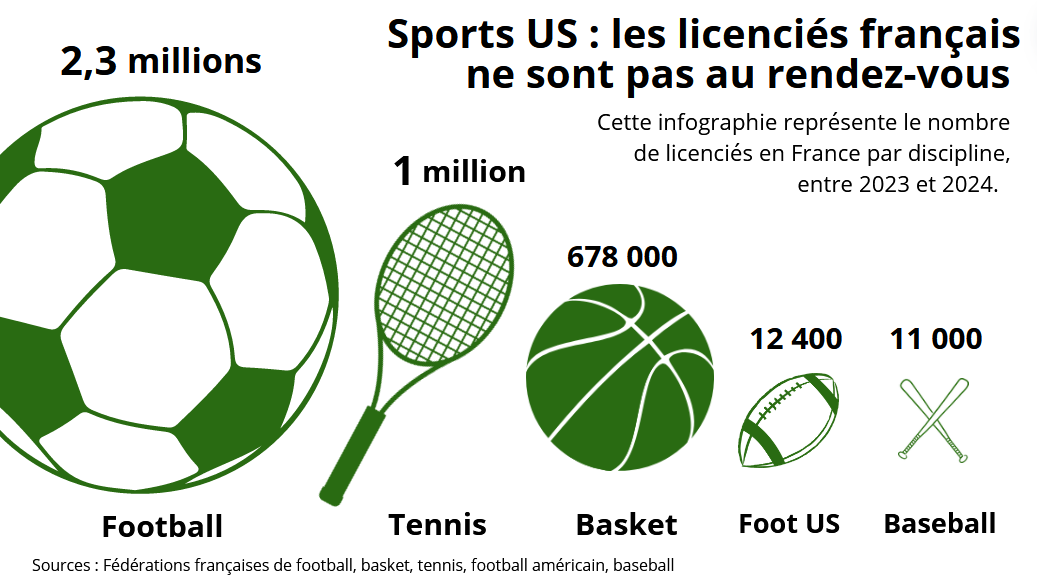Banjo ! Banjo ! Banjo ! », « Houston ! Seattle ! », “Jog ! Jog !”, « Check ! Check ! Check !», en l’espace de quelques minutes le coordinateur défensif Arnaud Mboutcha lance une ribambelle d’exclamations de ce genre aux joueurs seniors du Flash de la Courneuve, équipe française de première division. Pour quiconque ne connaîtrait pas le football américain, cette terminologie est un mystère. Il faut être rompu à ce sport d’outre-Atlantique pour comprendre qu’il s’agit là de noms de codes de stratégies, ou de directives exprimées en anglais. A leur écoute, dur d’imaginer que la scène se déroule en Seine-Saint-Denis et pas en plein milieu du Texas.
Il est 19h45 à La Courneuve (93), et les joueurs de première division se sont déjà répartis sur le terrain du Stade Géo André pour s’entraîner selon leurs postes. D’un bout à l’autre de l’espace, pas moins de trois équipes distinctes s’entraînent : l’offensive, l’attaquante et la « spéciale ». Dans chacune de ces équipes, une dizaine de postes différents, dont les noms ne sont pas traduits en français. « Il y a un vocabulaire très précis en anglais qui est intraduisible », explique Victor David, joueur amateur de football américain depuis une dizaine d’années. « J’ai toujours été bon en anglais et ça aide beaucoup dans ce sport. Ça m’a permis de comprendre vite », se remémore Badis Grami, quarterback de 26 ans du Flash.
Dans l’équipe offensive, le bien connu Quarterback (ou « QB », prononcé à l’américaine) est en réalité accompagné de « running-backs » ou encore d’« offensive linemen ». Chacune de ces catégories de joueurs est elle-même subdivisée en plusieurs postes précis. Cette multitude de postes est le signe d’un sport extrêmement stratégique, aux règles complexes, impossible à comprendre pour qui s’aventurerait à regarder un match par hasard. En France, le développement du football américain et des autres sports issus des Etats-Unis se heurte à de nombreuses barrières culturelles.
« Au début, j’avais peur de me faire casser la gueule »
Le football américain porte en France le poids d’un paradoxe : une similarité avec le rugby, très implanté dans l’hexagone, mais en même temps une différence qui se voit notamment dans la violence exceptionnelle de ce sport. « Les premiers coups font mal. Au début, j’avais peur de me faire casser la gueule », avoue Victor David. Badis Grami, a commencé la pratique à Grenoble « dans les tranchées », c’est-à-dire dans des postes de l’équipe offensive. Cette expression est le signe de l’aspect résolument militaire du football américain. « C’est un jeu où il faut gagner du terrain, le but est de marcher sur l’adversaire. C’est très militaire, très patriotique et beaucoup plus cadré que l’équivalent européen, le rugby qui est plus dans l’évitement, le temps continu », analyse Yann Descamps. Des différences qui pourraient signifier l’incompatibilité des philosophies sportives françaises et américaines.
Du côté du baseball, la philosophie est encore différente. « Les spectacles sportifs sont normalement très régulés au niveau du temps. Mais le baseball est l’un des rares sports où les matchs peuvent durer plusieurs heures », explique Yann Descamps. Il est ainsi très commun de voir les spectateurs de baseball sociabiliser, discuter et se restaurer lors des matchs. « En France, on vient pour un temps limité et on a plutôt une culture du spectateur qui peut influencer le résultat. Le supporter est plus investi, d’une certaine manière il est acteur du divertissement, il va chanter etc.», note le chercheur. Ces différentes cultures de stade sont un challenge supplémentaire pour qui voudrait s’intéresser à, sinon se lancer dans un sport américain en France.
Faire des sacrifices
Aux États-Unis, le sport est mis en avant très tôt dans les programmes scolaires et le sport universitaire a une importance majeure. « Les américains suivent l’équipe de leur ancienne faculté ou des facultés qu’ils détestent », note Yann Descamps. En 2023, le match opposant Georgia State contre Ohio State réunit près de 24 millions de téléspectateurs aux États-Unis, selon Sports Media Watch. Là-bas, « quand les jeunes arrivent en senior, ils ont tous déjà joué dans de vraies structures, au lycée ou à l’université. En France, on fait du sport dans des clubs après les cours. On sacrifie le reste pour en faire », explique Badis Grami. Ces différences structurelles expliquent en partie le monde qui sépare les réalités des athlètes de haut niveau de sports américains en France et aux États-Unis.
« Les joueurs ‘imports américains’ arrivent dans un club français de haut niveau comme le nôtre et peuvent se retrouver avec des gens qui jouent depuis deux ans seulement. Eux, ils jouent depuis qu’ils ont cinq ans », s’amuse Badis. Pour le QB, les sportifs de haut-niveau français se distinguent par leur passion. « Les imports sont parfois surpris de tous nous voir venir aux entraînements en hiver, alors qu’on n’est pas payés », rit-il.